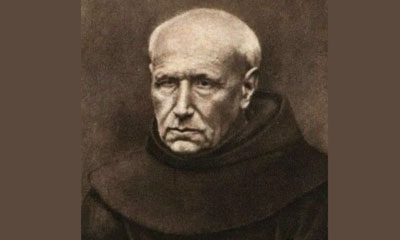8 mai 2024
Bienheureux Nicolas Sténon
Bien chers Amis,
Le 24 juin 1666, un savant danois protestant, renommé pour ses travaux d’anatomie, Niels Steensen, assiste à la procession de la Fête-Dieu à Livourne (Italie). Voyant la foule recueillie rendre hommage au Très Saint-Sacrement, il ne peut s’empêcher de penser : « Ou bien cette hostie n’est rien d’autre qu’un petit morceau de pain et tous ceux qui l’adorent sont des insensés, ou c’est vraiment le Corps du Christ et pourquoi est-ce que je ne L’honore pas moi aussi ? » Ses réflexions le conduiront à embrasser la foi catholique. Le Pape saint Jean-Paul II l’a béatifié le 23 octobre 1988.
 Niels Steensen est né le 11 janvier 1638 à Copenhague, capitale du Danemark. Connu en France, en particulier dans les milieux médicaux, sous le nom d’abord latinisé puis francisé de Nicolas Sténon, il est fils d’un orfèvre de la cour royale descendant d’une famille de pasteurs luthériens. Les heures passées dans l’atelier de son père permettent à l’enfant de développer son habileté manuelle innée, son goût pour la science et la technique ; il mesure le poids et le volume de l’or, construit un microscope et étudie la réfraction de la lumière. À dix ans, il fréquente l’école Notre-Dame, y fait ses humanités, étudie le latin et le grec, s’initie aux mathématiques et aux langues étrangères, pour lesquelles il fait preuve d’un don exceptionnel. Le Pape Jean-Paul II affirmera : « Toute la vie de Nicolas Sténon a été un pèlerinage infatigable à la recherche de la vérité, tant scientifique que religieuse, dans la conviction que toute découverte, même modeste, constitue un pas en avant vers la vérité absolue, vers ce Dieu dont dépend tout l’univers » (Homélie prononcée lors de la béatification, le 23 octobre 1988).
Niels Steensen est né le 11 janvier 1638 à Copenhague, capitale du Danemark. Connu en France, en particulier dans les milieux médicaux, sous le nom d’abord latinisé puis francisé de Nicolas Sténon, il est fils d’un orfèvre de la cour royale descendant d’une famille de pasteurs luthériens. Les heures passées dans l’atelier de son père permettent à l’enfant de développer son habileté manuelle innée, son goût pour la science et la technique ; il mesure le poids et le volume de l’or, construit un microscope et étudie la réfraction de la lumière. À dix ans, il fréquente l’école Notre-Dame, y fait ses humanités, étudie le latin et le grec, s’initie aux mathématiques et aux langues étrangères, pour lesquelles il fait preuve d’un don exceptionnel. Le Pape Jean-Paul II affirmera : « Toute la vie de Nicolas Sténon a été un pèlerinage infatigable à la recherche de la vérité, tant scientifique que religieuse, dans la conviction que toute découverte, même modeste, constitue un pas en avant vers la vérité absolue, vers ce Dieu dont dépend tout l’univers » (Homélie prononcée lors de la béatification, le 23 octobre 1988).
En 1654-1655, Copenhague est ravagée par la peste qui fait périr le tiers de la population. « Faites, Seigneur, demandera plus tard Nicolas, que nous ayons toujours à la pensée ces mots : “Memento mori – Souviens-toi qu’il faut mourir !” » À l’université de Copenhague, il étudie sous la direction d’un éminent médecin, Thomas Bartholin, dans le contexte difficile d’une guerre qui oppose le Danemark à la Suède, de 1657 à 1659. À l’automne de 1659, son maître lui conseille de poursuivre ses études à Amsterdam, puis à Leyde aux Pays-Bas, où la prospérité matérielle va de pair avec le développement culturel. Le grand peintre Rembrandt, citoyen de Leyde, est encore en pleine activité lorsque Nicolas s’y rend.
En mars 1660, Nicolas arrive à Amsterdam, ville où l’on se livre à des recherches anatomiques. Le 7 avril, il dissèque une tête de mouton et découvre le conduit qui, chez les mammifères, fournit à la bouche la plus grande partie de la salive, et qu’on appellera le “canal de Sténon”. Modestement, il parle d’une petite invention, qui pourtant fera de lui un savant célèbre connu des médecins du monde entier. En juillet 1660, il s’inscrit à l’université de Leyde ; il découvre de nombreuses glandes et publie une dizaine de mémoires. Avec d’autres scientifiques de renom, il étudie la structure des muscles, des vaisseaux sanguins et du cerveau ; le premier, il établit que le cœur est un muscle. Il noue des relations avec Spinoza (1632-1677), philosophe panthéiste et déterministe qu’il tentera plus tard de convaincre, mais en vain, de rejoindre avec lui la religion catholique. De retour à Copenhague en mars 1664, il présente au roi Frédéric III les fruits de son travail dans un mémoire “Des glandes et des muscles” qui sera qualifié de “petit livre d’or” par un naturaliste du xviiie siècle. Pour honorer sa science exceptionnelle, l’université de Leyde le nomme docteur en médecine “in absentia”, sans l’obliger à rédiger une thèse spéciale.
Ayant perdu sa mère, au mois de janvier 1660, Sténon décide de poursuivre ses études en France et arrive à Paris chez Melchisédech Thévenot (1620-1692), humaniste et mécène. Ce dernier tient des réunions de savants qui aboutiront, en 1666, à la fondation de l’Académie des Sciences. Nicolas procède à des dissections et prononce un discours sur l’anatomie du cerveau qui aura un grand retentissement. Il rédige aussi des dissertations sur l’embryologie, et s’avère être l’un des pionniers de l’anatomie comparée, c’est-à-dire celle qui compare un organe déterminé dans plusieurs espèces différentes. Sténon est frappé par la beauté de la création (par exemple une pierre précieuse ou le corps humain), mais il ne s’arrête pas là, car, dit-il, « le véritable but de l’anatomie est de permettre aux observateurs, à travers le chef-d’œuvre qu’est le corps, d’atteindre à la dignité de l’âme, et grâce à leurs merveilles à tous deux, d’accéder à la connaissance et à l’amour de leur Auteur » (Opera Philosophica, t. II, p. 254). Au cours de son séjour à Paris, il rencontre plusieurs personnes qui contribuent à son évolution religieuse, en particulier un jésuite, le Père de la Barre.
Sa seconde patrie
À la fin de l’été 1665, Nicolas voyage en France et passe à Montpellier dont la faculté de médecine jouit d’un renom particulier. Il y fait la connaissance d’éminents naturalistes anglais, avec lesquels il commence l’étude de la géologie. Arrivé en Italie au printemps de 1666, il se fixe à Florence, où il travaille avec les plus célèbres médecins. Il aimera cette ville comme sa seconde patrie. Par ses études anatomiques, il a attiré sur lui l’attention du grand-duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis. Nommé anatomiste de l’hôpital Santa Maria Nuova, il exerce la médecine et enseigne. Au sommet de sa carrière scientifique, à l’âge de vingt-huit ans, il est élu à “l’Accademia del Cimento”, un collège de chercheurs inspirés par les travaux de Galilée. À Florence puis à Rome, il rencontre plusieurs savants catholiques de grand renom dont le biologiste Marcello Malpighi. Leurs discussions portent également sur des questions de foi et les relations entre foi et science.
« La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité. C’est Dieu qui a mis au cœur de l’homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin que, Le connaissant et L’aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même » (Jean-Paul II, encyclique Fides et ratio, 14 septembre 1998, Introduction). Le Catéchisme de l’Église catholique affirme : « La recherche méthodique, dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d’une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi : les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Bien plus, celui qui s’efforce, avec persévérance et humilité, de pénétrer les secrets des choses, celui-là, même s’il n’en a pas conscience, est comme conduit par la main de Dieu, qui soutient tous les êtres et les fait ce qu’ils sont » (CEC, n° 159).
Au printemps de 1667, Sténon publie un mémoire sur les “Éléments de myologie” (étude des muscles). Il procède à la dissection de la tête d’un requin dont il compare les dents avec celles de requins fossilisés ; il en conclut que les fossiles sont les restes d’organismes vivants pétrifiés, pensée originale pour l’époque. En 1669, étudiant des cristaux de quartz d’origines et de formes différentes, il remarque que leurs faces forment toujours les mêmes angles entre elles. Cette découverte marque le début de la cristallographie moderne. Il décrit le phénomène de sédimentation et formule la notion de strate, puis démontre que l’on peut reconstituer l’histoire géologique d’une région.
« Je donnerais ma vie »
Pendant son séjour à Florence, Nicolas Sténon, déjà ébranlé à Paris par l’éloquence de Bossuet, se met à lire des livres catholiques et à comparer les différentes confessions chrétiennes. Son esprit et sa rigueur scientifiques, en quête de certitudes absolues, l’orientent vers les études théologiques. Deux femmes à la foi ardente exercent sur lui une profonde influence : sa pharmacienne habituelle à Florence, sœur Maria Flavia, religieuse qui a remarqué son incroyance, et lui apprend à prier pour obtenir la vraie foi. L’autre est Lavinia Cerami Adolfi, épouse d’un diplomate, à la personnalité à la fois forte et douce : aidée par son confesseur, un savant jésuite, elle instaure avec Nicolas des conversations spirituelles qui l’encouragent dans son évolution. Un jour que Sténon lui a déclaré ne pas voir de raisons suffisamment persuasives pour abandonner la religion de ses ancêtres, elle lui répond avec vivacité : « Si mon sang pouvait vous convaincre que c’est nécessaire, Dieu sait que je donnerais ma vie en ce moment même pour votre salut ! » Finalement, son étude théologique comparative du catholicisme et du luthéranisme, appuyée sur les écrits des auteurs anciens, le conduit à conclure que l’Église catholique est la véritable Église du Christ. En novembre 1667, éclairé par une grâce soudaine, il adhère totalement à la foi catholique et abjure publiquement, à Florence, la religion luthérienne. Le 8 décembre suivant, il reçoit la Confirmation des mains du nonce apostolique. Dans une lettre à un ami, il attribue sa conversion au mode de vie et de pensée des catholiques rencontrés au cours de ses premiers voyages aux Pays-Bas, en France et en Italie, à leur douceur, à leur charité, ainsi qu’aux longues conversations sur la religion qui ont noué entre eux et lui des liens d’amitié.
« Après avoir surmonté tous les doutes et les ténèbres, dira le Pape Jean-Paul II, rempli de joie intérieure, Sténon a dit son “oui” à ce que Dieu lui avait donné de comprendre clairement » (Homélie de béatification). Le second concile du Vatican affirme : « Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et le bonheur dans le Christ. Cette unique vraie religion, nous croyons qu’elle subsiste dans l’Église catholique et apostolique à laquelle le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu’il dit aux Apôtres : Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit (Mt 28, 19-20). Tous les hommes, d’autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église ; et, quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles » (Déclaration Dignitatis humanæ, n° 1).
Une situation incertaine
Nicolas se rend en Amsterdam au printemps de 1670. Là, il retrouve des savants de sa connaissance, avec qui il s’entretient de sujets scientifiques et religieux. Ces rencontres le décident à consacrer sa vie à ramener d’autres croyants à la foi catholique. En 1672, sur invitation du roi, désireux de le faire revenir au pays, il rentre au Danemark et s’installe chez sa sœur, dont le mari a repris l’atelier d’orfèvrerie de leur père. Il obtient un poste d’anatomiste royal, mais il perçoit bientôt que les autorités du pays ne sont pas disposées à lui accorder de bonnes conditions de travail. On se défie de ce catholique, et sa situation reste incertaine. Sans avenir dans ce Danemark très protestant, il quitte Copenhague le 14 juillet 1674 pour regagner l’Italie. Il passe par Hanovre, où le duc Jean-Frédéric, converti au catholicisme, lui demande de réaliser un travail d’anatomie. Il fait plusieurs dissections devant la cour pour démontrer la circulation du sang et faire voir la structure du cœur. À la table du duc, il a des conversations religieuses avec les courtisans et les prédicateurs de la ville. Fin 1674, il arrive à Florence, où il est chargé de l’éducation du jeune prince de douze ans, le futur Ferdinand III, auquel il apprend les sciences naturelles mais aussi les devoirs religieux et moraux.
En 1675, huit ans après sa conversion, un long cheminement spirituel et des études théologiques sérieuses, il est ordonné prêtre à Florence. « Il fut, disait le Pape Jean-Paul II, le grand scientifique qui reconnut Dieu comme Seigneur suprême, acceptant de suivre son appel intérieur à se donner totalement au Christ et à mettre ses énergies au service exclusif de l’Évangile. C’est ainsi que Sténon, non satisfait de l’engagement apostolique d’un laïc, voulut être prêtre, convaincu que cela ne constituait pas une fracture dans sa vie et son itinéraire, mais plutôt un pas en avant vers une vie plus complète, don de lui-même pour le bien de l’humanité » (Homélie de béatification). Par la suite, lorsqu’on lui demandera pourquoi il s’est fait prêtre, Nicolas répondra : « Quand j’essaie de me faire une idée des bienfaits de Dieu envers moi, et je ne pourrai jamais y arriver complètement, je les trouve si grands que cela me pousse à Lui offrir ce que j’ai de meilleur, et cela le mieux possible. Ayant aussi reconnu la dignité du prêtre, qui chaque jour sur l’autel présente ses actions de grâces pour les bienfaits reçus, son expiation pour les péchés commis et toute offrande qui puisse plaire à Dieu, j’ai demandé et obtenu la faveur de pouvoir présenter au Père éternel, pour moi et pour les autres, l’offrande pure et immaculée. » La démarche spirituelle de Nicolas : reconnaissance et offrande de lui-même, est semblable à celle de saint Ignace dans sa célèbre prière : « Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai et tout ce que je possède. Vous me l’avez donné, Seigneur, je vous le rends ! » (Exercices spirituels, n° 234).
Sténon entretient le duc Côme III de Médicis des rapports entre sa vie politique et le salut de son âme. Il le porte en particulier à certains renoncements à la vie somptueuse de sa famille et de sa cour, au profit d’un allègement des charges fiscales qui pèsent sur le peuple. Il prêche volontiers sur les rapports entre la foi et la raison, et rédige de nombreux écrits pour réfuter les multiples critiques dont il est l’objet dans les milieux savants de son pays, mais aussi d’Allemagne et des Pays-Bas. La conversion d’un savant si illustre n’est pas passée inaperçue parmi eux, et ils estiment qu’elle leur « fait un grand tort ». Il poursuit ses recherches en géologie, facilitées par la présence, aux alentours de Florence, de carrières où l’on trouve de nombreux fossiles.
Explication et source du désir
En 1677, la reine du Danemark transmet au Pape le désir de son frère, le duc de Hanovre, d’avoir Nicolas Sténon comme évêque. Le Souverain Pontife accepte cette requête. L’élu se rend alors à Rome à pied, en pauvre pèlerin, mendiant son pain quotidien, pour se préparer dans l’humilité à la consécration épiscopale. Le bienheureux Pape Innocent XI le fait sacrer évêque par le saint cardinal Grégoire Barbarigo, et lui confie le soin des catholiques de tous les pays du nord de l’Europe passés au protestantisme. « Riche d’amour, même de souffrance, dira le Pape Jean-Paul II, Mgr Sténon était passionné par le Christ crucifié, le grand prêtre… Le blason qu’il a choisi, un cœur surmonté d’une croix, symbolise et résume clairement l’orientation profonde de son existence. Il a voulu mettre toute sa vie au service de la croix du Christ, dans laquelle il a vu la parole définitive de l’amour de Dieu pour l’humanité… La profonde conviction que le Christ est la lumière du monde et que ce n’est qu’en le rencontrant que l’homme peut bénéficier de la lumière de la vie, a été la force motrice qui a poussé Nicolas Sténon à ne ménager aucune énergie pour annoncer l’Évangile. Son désir missionnaire trouve ici son explication et sa source » (ibid.).
À Hanovre, Mgr Sténon rencontre Leibniz (1646-1716), mathématicien et philosophe idéaliste qui dira de lui : « Il était un grand anatomiste, et fort versé dans la connaissance de la nature, mais il en abandonna malheureusement la recherche, et, d’un grand physicien, il devint un théologien médiocre. » Leibniz était protestant, mais il ne parvint jamais à admettre la Révélation divine comme fait historique indiscutable.
La Réforme protestante avait entraîné au xvie siècle la quasi disparition de l’Église catholique dans d’immenses territoires, et le Saint-Siège dut supprimer la totalité des diocèses du nord de l’Allemagne et de la Scandinavie. Seuls de petits groupes étaient demeurés fidèles à la foi catholique. En 1667, cette région a été confiée à un vicaire apostolique (évêque dépendant du Saint-Siège). Mgr Sténon, le deuxième à remplir cette charge, œuvre à Hanovre et aux alentours jusqu’en 1680, prêchant non seulement en allemand, mais aussi en français et en italien, car les catholiques y sont surtout des étrangers. Il réconforte le petit troupeau catholique et dialogue avec tous, les luthériens, les savants, fussent-ils incroyants. Sa vie est « un exemple lumineux d’ouverture et de dialogue » (saint Jean-Paul II, ibid.). Son témoignage montre « comment, par la droiture associée à la distinction et à la délicatesse, aux mœurs exemplaires et à la sainteté de vie, on peut et on doit établir ces rapports qui facilitent la compréhension réciproque, l’amour et l’unité » (ibid.). Le Pape saint Jean XXIII dira de Nicolas Sténon : « Ayant parcouru lui-même le laborieux itinéraire qui le conduisit au cœur de l’Église de Jésus-Christ, il éprouvait un véritable tourment intérieur à la pensée des nombreuses âmes – celles notamment de ses compatriotes – qui étaient privées de la pleine lumière de la Révélation, et il brûlait d’un désir ardent de les entraîner sur sa route de vérité… Ce tourment fut la source d’une activité inlassable, marquée par les deux traits auxquels on reconnaît les vrais fils de l’Église : un attachement inviolable à tous les points de la doctrine révélée, un grand respect et une affectueuse charité à l’égard de ceux qui ne partagent pas nos convictions » (14 octobre 1959).
Une extrême modestie
Le grand-duc de Hanovre est mort en 1679, et son frère, un protestant, lui a succédé. En dépit d’une certaine bienveillance de ce dernier, Mgr Sténon n’a plus la même liberté. Il accepte alors une mission à Münster, en Westphalie, qui se transforme bientôt en une charge d’évêque auxiliaire du prince-évêque de Paderborn. La santé de celui-ci se dégradant, Mgr Sténon le remplace souvent, et, par humilité, il se déplace à pied. Ses paroles sont un vrai réconfort pour les catholiques ; lui-même se compare volontiers à un médecin qui doit connaître chacun de ses malades. Il « montrait une grande dignité et une extrême modestie », dira son chapelain. Il se fait aussi mendiant auprès du prince-évêque pour les fidèles, qui sont souvent dans la misère. À la mort du prince-évêque, en 1683, le chapitre des chanoines fait opposition à Mgr Sténon, qui aurait dû prendre sa succession. Percevant que d’importants intérêts financiers sont à la racine de ce conflit, le prélat prend le parti de se retirer.
En 1684, il renonce au ministère actif et se rend à Schwerin (Mecklembourg – Allemagne du nord), où il vit dans l’ascèse, tout en reprenant ses travaux scientifiques sur le cerveau et le système nerveux. Vêtu pauvrement, il se nourrit quatre jours par semaine de pain et de bière. Il va jusqu’à vendre sa crosse et son anneau pastoral pour subvenir aux besoins des pauvres, gestes qui édifient davantage qu’une belle homélie. Il se considère comme un grand pécheur qui doit réparer ses fautes ; mais extérieurement il est fort gai. Comprenant que désormais il ne peut plus remplir de mission dans les pays nordiques, il décide de rejoindre l’Italie. Mais une maladie intestinale l’atteint et lui cause de grandes souffrances. Avant de mourir, il s’adresse au Seigneur : « Jésus, soyez mon Sauveur ! Je chanterai votre miséricorde durant l’éternité ! » Il meurt le 26 novembre (ou le 5 décembre) 1686, à Schwerin. Son corps est transporté à Florence et inhumé dans la basilique San Lorenzo près des Médicis, ses protecteurs.
Considérant sa vertu et sa piété remarquables, saint Jean-Paul II l’a déclaré bienheureux : « Le secret de son existence, disait le Pape, réside entièrement en ceci : s’il est célèbre par les découvertes faites dans le domaine de l’anatomie, ce qu’il nous indique par son choix de vie est bien plus important. Grâce à la “science du cœur”, Nicolas Sténon a découvert Dieu, Créateur de tout ce qui existe et Sauveur du monde, et il s’en est fait le héraut passionné au milieu de ses frères » (ibid.). Demandons au bienheureux, célébré par l’Église catholique le 5 décembre, de nous aider à témoigner de la vérité de Dieu, Bonté infinie, et de son Amour.