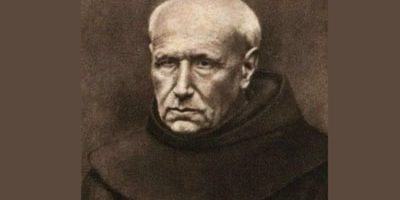28 février 2024
Bienheureux Valentin Paquay
Bien chers Amis,
Le Pape saint Jean-Paul II voyait dans la pauvreté volontaire de la vie religieuse une réponse à l’idolâtrie de l’argent dont souffre notre monde marqué par « un matérialisme avide de possession, indifférent aux besoins et aux souffrances des plus faibles et même dépourvu de toute considération pour l’équilibre des ressources naturelles. La réponse de la vie consacrée se trouve dans la pauvreté évangélique, vécue sous différentes formes et souvent accompagnée d’un engagement actif dans la promotion de la solidarité et de la charité » (Exhortation apostolique Vita consecrata, nos 89-90). Le bienheureux Valentin Paquay a embrassé un genre de vie consacrée spécialement fondée sur la pratique de la pauvreté.
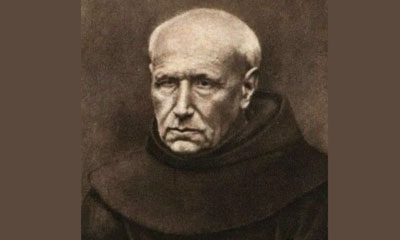 Jean-Louis Paquay est né à Tongres, dans le Limbourg belge, le 17 novembre 1828. Cité antique, Tongres est dominé par l’église Notre-Dame, du xiiie siècle, centre de pèlerinage marial. Le père du garçon, Henri, d’origine wallonne, est cultivateur ; sa mère appartient à une famille bourgeoise du lieu. Après leur mariage, en 1821, ils tiennent une auberge dans le bourg, ce qui leur permet une modeste aisance. Ils donnent naissance d’abord à trois enfants qui sont emportés très jeunes par une épidémie, puis viennent une fille, Marie, et Jean-Louis. Celui-ci est baptisé le jour même de sa naissance. Cinq autres enfants naîtront au foyer Paquay. La préoccupation principale de ces parents profondément chrétiens est l’éducation religieuse et morale de leurs enfants. Jean-Louis est doté d’un caractère impétueux, que l’on s’applique à réformer, mais qui se manifestera parfois encore lorsqu’il sera devenu religieux.
Jean-Louis Paquay est né à Tongres, dans le Limbourg belge, le 17 novembre 1828. Cité antique, Tongres est dominé par l’église Notre-Dame, du xiiie siècle, centre de pèlerinage marial. Le père du garçon, Henri, d’origine wallonne, est cultivateur ; sa mère appartient à une famille bourgeoise du lieu. Après leur mariage, en 1821, ils tiennent une auberge dans le bourg, ce qui leur permet une modeste aisance. Ils donnent naissance d’abord à trois enfants qui sont emportés très jeunes par une épidémie, puis viennent une fille, Marie, et Jean-Louis. Celui-ci est baptisé le jour même de sa naissance. Cinq autres enfants naîtront au foyer Paquay. La préoccupation principale de ces parents profondément chrétiens est l’éducation religieuse et morale de leurs enfants. Jean-Louis est doté d’un caractère impétueux, que l’on s’applique à réformer, mais qui se manifestera parfois encore lorsqu’il sera devenu religieux.
À l’âge de cinq ans, l’enfant est scolarisé au collège communal de Tongres. Il se fait remarquer par son aptitude pour les études, mais aussi par sa piété, sa docilité et sa gentillesse. En 1835, des Pères rédemptoristes (membres d’un Ordre fondé en 1732 par saint Alphonse de Liguori) viennent prêcher une mission paroissiale de quinze jours dans l’église Notre-Dame de Tongres. De nombreux fidèles y prennent part, écoutant les sermons, participant aux cérémonies et se confessant auprès des religieux. Jean-Louis se confesse pour la première fois : il attend longtemps son tour, laissant systématiquement passer les adultes. Le confesseur s’en aperçoit, l’appelle et l’écoute. Touché par la grâce, le garçon perçoit que sa vocation est d’exercer un ministère semblable. Un attrait pour la prière se manifeste dès lors chez Jean-Louis. Après une préparation sérieuse, il fait sa première Communion en 1840, à l’âge de douze ans.
En 1845, l’adolescent entre en classe de rhétorique au petit séminaire de Saint-Trond. Assidu aux études, il n’est pourtant pas un élève brillant, mais sa piété et son esprit religieux impressionnent son entourage. Dès qu’une place d’enfant de chœur se libère à Notre-Dame, il est désigné pour la prendre. Tous les matins, avant de se rendre en classe, il sert une Messe avec ferveur. Sa délicatesse de conscience dégénère en scrupule. Il racontera qu’à cette époque, il en était venu, pendant deux mois, à se confesser chaque jour.
Le scrupule est une crainte mal fondée de commettre une faute. Dans ses Exercices spirituels, saint Ignace en décrit avec finesse la manifestation : « On nomme assez communément scrupule un jugement libre et volontaire par lequel nous prononçons qu’une action est péché lorsqu’elle ne l’est pas ; par exemple, lorsqu’il arrive à quelqu’un de juger qu’il a péché en mettant le pied par hasard sur deux brins de paille en forme de croix. Or, ceci est plutôt, à proprement parler, un jugement erroné qu’un scrupule. Mais après avoir marché sur cette croix, ou après avoir fait, dit ou pensé une chose quelconque, il me vient du dehors la pensée que j’ai péché ; d’un autre côté, il me semble intérieurement que je n’ai pas péché. J’éprouve en cela du trouble, en tant que je doute et ne doute pas : or, c’est là à proprement parler un scrupule et une tentation que l’ennemi fait naître en moi » (nos 346-347).
Le véritable scrupule étant involontaire et spontané, on le soignera non pas en l’empêchant de naître, mais en le traitant par le mépris, tout « en tâchant de s’établir solidement dans un sage milieu » (Exercices de saint Ignace, n° 350). À cette fin, l’obéissance totale et confiante aux directives d’un confesseur expérimenté est d’une aide très précieuse et, au moins pour un temps, nécessaire. En effet, le scrupule se cache sous des jugements erronés qui trompent sous apparence de bien. Le secours du confesseur est donc fort utile pour rectifier ces jugements et ne pas se laisser entraîner par eux dans des voies nocives. Le prêtre d’ailleurs apprendra peu à peu à son pénitent à se passer de son aide. Prière et renoncement à soi disposent aussi puissamment à se libérer du scrupule.
Ne pas faire les choses à moitié
La piété mariale de Jean-Louis est intense. Un an après sa première Communion, à l’âge de treize ans, à la suite d’une prédication, il fait le vœu de chasteté perpétuelle aux pieds de Notre-Dame de Tongres. Assidu aux prédications, surtout en période de carême où elles ont lieu chaque jour, il est particulièrement ému à l’évocation de la Passion de Notre-Seigneur qui suscite en lui de profonds sentiments d’amour envers son Sauveur. Le seul défaut de sa vie au petit séminaire consiste dans son refus constant de participer aux jeux de ses camarades ; sa manière de refuser est toutefois si gracieuse que personne ne s’en formalise. Il préfère la lecture et surtout les visites au Saint-Sacrement. En 1847, la mort de son père le plonge dans une grande douleur ; il en devient alors plus sérieux encore. À cette époque, Jean-Louis éprouve une certaine crainte d’être appelé à la vie religieuse ; il passe rapidement sur les passages des livres spirituels qui en traitent. Mais la pensée de la mort le fait réfléchir : « Aurai-je à l’heure de ma mort l’occasion de me confesser ? Je n’en sais rien… Quelles seront alors mes dispositions intérieures ? Où mourrai-je ? Sera-ce dans un cloître ? Sera-ce dans l’habit de saint François ? Mystère pour moi, mais arrive ce que pourra, je vais me préparer à la mort dès ce moment. » Bientôt ses supérieurs perçoivent effectivement en lui une vocation religieuse. De fait, en 1849, la bénédiction de sa mère obtenue, il finit par avouer à ses condisciples du séminaire qu’il désire une vie plus austère et plus parfaite au service de Dieu : le lendemain, il entre chez les Franciscains. Il a vingt et un ans. Après un temps de probation, il est admis, avec sept autres jeunes, à la prise d’habit, qui marque le début du noviciat. Il fait celui-ci à Tielt près de Gand, l’un des centres de la province franciscaine belge. Dans ces dispositions ferventes, il écrit : « Celui qui se fait religieux dans un autre but que de devenir un saint, celui-là est un sot dans toute la force du terme… », et : « Il ne faut pas faire les choses à moitié… Ne nous contentons pas d’un bon vouloir. »
« Dans l’Église, en ce qui concerne sa mission de manifester la sainteté, écrit le Pape saint Jean-Paul II, il faut reconnaître que la vie consacrée se situe objectivement à un niveau d’excellence, car elle reflète la manière même dont le Christ a vécu. C’est pourquoi il y a en elle une manifestation particulièrement riche des biens évangéliques et une mise en œuvre plus complète de la finalité de l’Église, qui est la sanctification de l’humanité. La vie consacrée annonce et anticipe en quelque sorte le temps à venir, dans lequel, une fois survenue la plénitude du Royaume des cieux, qui est déjà présent maintenant en germe et dans le mystère, les fils de la Résurrection ne prendront plus ni femme ni mari, mais seront comme des anges de Dieu (cf. Mt 22, 30) » (Vita consecrata, 25 mars 1996, n° 32).
Une redoutable responsabilité
Lorsqu’il prononce ses vœux, le 4 octobre 1850, Jean-Louis devient le Frère Valentin. Auparavant, il avait écrit une lettre à sa mère et à ses tantes pour leur demander pardon de toutes les peines qu’il avait pu leur occasionner ; il considère, en effet, l’engagement des vœux religieux comme le début d’une nouvelle vie qu’il souhaite aborder dans la plus grande pureté. Il suit ensuite le cours de philosophie à Rekem, puis celui de théologie à Saint-Trond. Il laissera dans ces maisons le souvenir d’un jeune religieux assoiffé de progrès spirituel et de connaissances utiles pour le salut des âmes. À la veille de son ordination sacerdotale, pris de peur devant la responsabilité qu’il va assumer, il se cache. On le retrouve cependant et il accepte de devenir prêtre. La cérémonie se déroule à Liège le 10 juin 1854. Frère Valentin a vingt-six ans.
Quelques jours plus tard, on l’envoie au couvent de Hasselt (Belgique), où il exercera son ministère durant une cinquantaine d’années. Au mois d’août, il reçoit les pouvoirs de confesser (c’est-à-dire l’autorisation de donner le sacrement de Pénitence) ainsi que la permission de prêcher, et il commence immédiatement ces ministères dans lesquels il excelle. Aussi, lorsqu’en 1857 ses supérieurs l’envoient à Thielt, les fidèles d’Hasselt sont bouleversés : ils insistent tant auprès des supérieurs qu’au bout de dix mois le Père leur est rendu. Lui-même reçoit ces ordre et contre-ordre dans un grand esprit de foi, y voyant la volonté de Dieu. Bientôt son grand dévouement et son humilité profonde lui font donner le surnom de “Heilig Paterke” (le “saint petit Père”).
On lui attribue un confessionnal dans la basilique Notre-Dame, où il passe la plus grande partie de ses journées. Son accueil et sa miséricorde attirent les foules au point qu’à l’instar du Curé d’Ars, ce ministère devient son apostolat principal. En plus de sa science et de sa prudence, il est favorisé de lumières surnaturelles et d’une certaine aptitude à lire dans les âmes, les libérant parfois d’un grand poids. Aussi y a-t-il toujours une file d’attente devant son confessionnal. Plusieurs pénitents témoigneront qu’en sa présence, leur conscience s’est ouverte comme jamais auparavant. En général, il est bref et très réservé dans ses admonitions, mais les pénitents se relèvent touchés et convertis. D’autres fois, lui-même énumère les péchés du pénitent comme s’il y avait assisté, ou bien, il rappelle certaines fautes oubliées, non en accusateur mais toujours avec une grande discrétion ; le pénitent n’en est ni humilié, ni accablé, car il se sent compris et pardonné.
Le serviteur du pardon
« En célébrant le sacrement de la Pénitence, enseigne le Catéchisme de l’Église catholique, le prêtre accomplit le ministère du Bon Pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du Bon Samaritain qui panse les blessures, du Père qui attend le Fils prodigue et l’accueille à son retour, du juste Juge qui ne fait pas acception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l’instrument de l’amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Le confesseur n’est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit s’unir à l’intention et à la charité du Christ. Il doit avoir une connaissance éprouvée du comportement chrétien, l’expérience des choses humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est tombé ; il doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l’Église et conduire le pénitent avec patience vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du Seigneur » (CEC, nos 1465-1466).
De son côté, le pénitent doit se disposer à recevoir la grâce, qui n’agit jamais sans la libre coopération de l’homme. La première disposition est la contrition. Celle-ci est une douleur de l’âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir. En second lieu, l’aveu de ses fautes au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence : les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes (péchés véniels) est néanmoins vivement recommandée par l’Église. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l’Esprit. L’absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés (cf. CEC, nos1451, 1456 et 1458). Pour réparer le dommage causé par le péché, le pénitent doit encore accomplir certains actes imposés par le confesseur, c’est la satisfaction, appelée aussi pénitence, qui constitue le troisième acte du pénitent (cf. Compendium du Catéchisme, n° 303). « Toute l’efficacité de la Pénitence, ajoute le Catéchisme, consiste à nous rétablir dans la grâce de Dieu et à nous unir à Lui dans une souveraine amitié. Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu… Ce sacrement nous réconcilie aussi avec l’Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle. Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure » (CEC, nos 1468-1469).
L’empressement du Père Valentin à se rendre au confessionnal ne provient pas d’un goût personnel. Comme en tout le reste, il puise ses motivations dans la foi et l’obéissance surnaturelles. Sa sollicitude particulière va aux pécheurs les plus enfoncés dans le mal ou dans l’ignorance. Après avoir confessé pendant plusieurs heures, il lui arrive de se mettre à genoux pour prier ; le frère sacristain, venu pour fermer l’église, le trouve endormi de fatigue sur les marches de l’autel… Il exerce aussi le ministère de confesseur ordinaire ou extraordinaire de plusieurs communautés religieuses. Des âmes en recherche de leur vocation se mettent parfois sous sa direction ; celle-ci est marquée par une grande discrétion. Plusieurs personnes lui doivent d’avoir trouvé la lumière, et d’être ainsi devenues prêtres, religieux ou religieuses. Il prêche également des missions et des retraites. Ses auditeurs sentent qu’il leur transmet le fruit de son oraison. Son ministère s’étend aux malades et aux mourants. Quand, de nuit, on frappe au couvent pour chercher un confesseur en faveur d’un mourant, c’est presque toujours lui qui est demandé nommément. Il reste alors, en général, de nuit comme de jour, longuement auprès du malade. Un jour, on parle au Père Valentin d’un malade qui ne veut absolument pas voir de prêtre ; il se rend tout de même au domicile. Il se fait annoncer, en demandant la permission de lui rendre visite, et, surprise, le malade accepte. Lorsqu’il repart, le malade, qui s’est confessé, est rempli de joie. En 1864, une épidémie de variole se déclenche à Hasselt. Victime de son dévouement, le Père est atteint à son tour par la maladie, et il lui faut rester au lit pendant cinq semaines. Un frère, qui l’a soigné avec diligence, est bientôt atteint. À peine convalescent, le Père Valentin obtient de le soigner lui-même.
Toujours prier
Dans ses homélies, il se fait l’apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et à l’Eucharistie. Il encourage tous ceux qui le peuvent à la communion fréquente, anticipant les décrets de saint Pie X. Il pratique d’une manière peu ordinaire le précepte du Seigneur selon lequel il faut toujours prier (Lc 18, 1). Gardant toujours en main son chapelet ou le bréviaire, il récite l’un ou l’autre dès qu’il le peut. En déplacement hors du couvent, la porte franchie, il commence le chapelet. Cela ne convient pas toujours à ceux qui l’accompagnent et qui, parfois, auraient préféré profiter de l’occasion pour s’entretenir avec lui. Le Père Valentin souhaite quitter Hasselt pour échapper à la vénération qu’on lui porte. Lorsqu’il doit séjourner dans un autre couvent, il cherche toujours à occuper la dernière place, avec les frères convers. Plusieurs fois nommé vice-gardien de son couvent et même gardien (c’est-à-dire supérieur), il manifeste dans ces fonctions une grande bonté et une profonde humilité. En 1890, il est élu visiteur de la province. Si on parle de sa sainteté, il réussit le plus souvent à tourner le compliment en plaisanterie. Il reçoit pourtant des grâces extraordinaires qu’il s’applique à cacher, mais certaines de ses extases ont eu des témoins. Ces grâces extraordinaires ne le détournent pas de la pratique de l’obéissance. Quoi qu’il fasse, au premier coup de cloche il s’interrompt, voyant dans cet appel la voix de Dieu. Lorsqu’il prêche une retraite à une communauté de Sœurs, il obéit à la supérieure de la même façon qu’à son propre supérieur. Son obéissance aux prescriptions des médecins est si parfaite qu’ils en sont eux-mêmes étonnés.
Entré dans l’Ordre de saint François, où la pauvreté est spécialement à l’honneur, le Père Valentin ne possède absolument rien. Dans sa cellule on trouve seulement les quelques livres qui lui sont nécessaires. Il porte ses vêtements jusqu’à leur usure complète, et lorsque la décence l’oblige à les changer, il demande à récupérer de vieux habits rapportés à la lingerie par un confrère. En revanche, lorsqu’on le prie de remplir la fonction de frère quêteur, il accepte avec joie cette tâche ingrate. S’il lui faut se rendre dans un bourg voisin, à sept kilomètres, pour entendre les confessions, il fait le trajet à pied. Quand il va prêcher des retraites ou des missions, il part sans valise, n’emportant que son bréviaire.
La véritable richesse
« Avant même d’être un service des pauvres, la pauvreté évangélique est une valeur en soi, car elle évoque la première des Béatitudes par l’imitation du Christ pauvre. En effet, son sens primitif est de rendre témoignage à Dieu qui est la véritable richesse du cœur humain. C’est précisément pourquoi elle conteste avec force l’idolâtrie de Mammon, en se présentant comme un appel prophétique face à une société qui, dans de nombreuses parties du monde riche, risque de perdre le sens de la mesure et la valeur même des choses » (Jean-Paul II, Vita consecrata, n° 90). Dans un discours sur la vie économique, le Pape François affirmait : « L’argent est important, surtout quand il n’y en a pas, et que c’est de lui que dépendent la nourriture, l’école, l’avenir des enfants. Mais il devient une idole quand il devient un objectif. L’avarice, qui n’est pas un vice capital par hasard, est un péché d’idolâtrie parce qu’alors l’accumulation d’argent pour lui-même devient l’objectif de l’action… Quand le capitalisme fait de la recherche du profit son unique but, il risque de devenir une structure idolâtre » (4 février 2017).
Après quarante ans de services pastoraux à la basilique Notre-Dame Virga-Jessé, et dix ans à l’église Saint-Roch, toutes deux à Hasselt, le Père pressent que sa fin est proche. Il annonce même à l’une de ses pénitentes qu’il ne lui reste plus que huit mois de vie. Il souffre d’une bronchite chronique. L’hiver de 1904-1905 est particulièrement pénible, mais le Père tâche de cacher ses souffrances. Le 11 décembre, il se rend encore à son confessionnal, mais ses pénitents perçoivent bien qu’il est épuisé. Le lendemain, son état est tel qu’il ne peut se lever. À un visiteur qui exprime de la compassion, il affirme : « Ce n’est rien ; ne dois-je pas souffrir quelque chose puisque je l’ai mérité ? Les jambes font mal, il est vrai… mais Dieu le veut ainsi. » Le 15 décembre, il reçoit les derniers sacrements. Par un effort considérable, il communie à genoux, puis demande à la communauté de lui pardonner les scandales qu’il a pu occasionner. Tôt le matin du 1erjanvier 1905, il assiste à une Messe célébrée à l’infirmerie. À midi, il répond encore aux prières de l’Angélus ; il cesse de respirer à 15 heures, à l’âge de 76 ans. Son tombeau attire des pèlerins en grand nombre. Il a été béatifié par saint Jean-Paul II en 2003. Liturgiquement, il est commémoré le 1er janvier.
« Le prêtre Valentin Paquay, affirmait le Pape saint Jean-Paul II, est bien un disciple du Christ et un prêtre selon le cœur de Dieu. Apôtre de la miséricorde, il passait de longues heures au confessionnal avec un don particulier pour remettre les pécheurs sur le droit chemin, rappelant aux hommes la grandeur du pardon divin. En mettant au centre de sa vie de prêtre la célébration du Mystère eucharistique, il invite les fidèles à s’approcher souvent de la communion au Pain de Vie » (Homélie de la béatification, 9 novembre 2003). En recourant régulièrement aux sacrements de Pénitence et d’Eucharistie, nous puiserons avec joie aux sources du salut (Is 12, 3) qui s’écoulent du Cœur de Jésus.