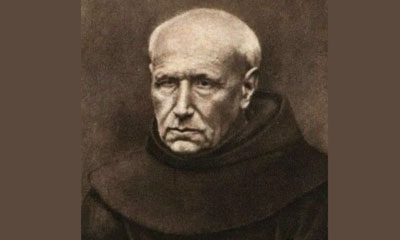3 avril 2024
Vénérable Edel Marie Quinn
Bien chers Amis,
Évangélisée dès le VIe siècle par saint Patrick, l’Irlande a envoyé dans le monde de nombreux missionnaires. En 1921, y était fondée, à Dublin, la Légion de Marie, association laïque de catholiques qui, avec l’approbation de l’Église et sous la puissante direction de Marie Immaculée, cherche à procurer la gloire de Dieu à travers la sanctification de ses membres, la prière et le service bénévole du prochain. Elle vise à apporter Marie au monde comme moyen infaillible de gagner le monde à Jésus. Aujourd’hui, c’est une organisation comptant plusieurs millions de membres, dans environ 170 pays.
 Le 15 décembre 1994, le Pape saint Jean-Paul II déclarait vénérable Edel Marie Quinn, membre de la Légion de Marie. Née à Kanturk, en République d’Irlande (Sud), le 14 septembre 1907, l’enfant reçoit le Baptême quatre jours après. Ses parents ont choisi le prénom d’Adèle, mais le prêtre comprend Edel ; pensant qu’il s’agit de la fleur edelweiss, il ne s’informe pas davantage et inscrit ce nom sur le registre. Edel est l’aînée de sa famille ; quatre frères et sœurs la suivront. Charles, le père, est employé de banque ; en raison de ses promotions, il déménagera souvent avec les siens, avant de s’établir définitivement à Dublin en 1924. Mme Quinn donne l’exemple d’une bonté active, attentive et délicate, animée d’une profonde piété.
Le 15 décembre 1994, le Pape saint Jean-Paul II déclarait vénérable Edel Marie Quinn, membre de la Légion de Marie. Née à Kanturk, en République d’Irlande (Sud), le 14 septembre 1907, l’enfant reçoit le Baptême quatre jours après. Ses parents ont choisi le prénom d’Adèle, mais le prêtre comprend Edel ; pensant qu’il s’agit de la fleur edelweiss, il ne s’informe pas davantage et inscrit ce nom sur le registre. Edel est l’aînée de sa famille ; quatre frères et sœurs la suivront. Charles, le père, est employé de banque ; en raison de ses promotions, il déménagera souvent avec les siens, avant de s’établir définitivement à Dublin en 1924. Mme Quinn donne l’exemple d’une bonté active, attentive et délicate, animée d’une profonde piété.
Une religieuse qui a connu Edel alors qu’elle avait dix ans, témoignera : « C’était un vrai diablotin à l’école, non qu’elle fût impertinente, mais elle était toujours débordante d’entrain, vivante et joyeuse, à l’affût des niches à faire… À la simplicité de l’enfant, elle unissait une réelle maîtrise de soi et un grand charme… Son désintéressement et sa complaisance étaient remarquables. Organisatrice née, elle faisait bien tout ce qu’elle entreprenait. » La jeune fille excelle en sport et en danse. Elle reçoit une solide formation chrétienne. De sa première Communion, en 1916, elle gardera la faim de l’Eucharistie. Des revers de fortune de son père obligent Edel à interrompre ses études et à rentrer à la maison. Elle va tous les jours à la Messe et lit beaucoup.
À dix-neuf ans, la jeune fille cherche un emploi. Engagée comme secrétaire dans une maison d’importation, fondée depuis peu à Dublin par un Français, elle y laissera le souvenir d’une personne timide mais vaillante. Elle s’adapte rapidement et devient une secrétaire capable d’accomplir des missions de confiance. Elle apprend le français ; sa vie spirituelle profitera beaucoup des auteurs de cette langue. Dès sa première rencontre, son employeur avait été frappé par son sourire : « Quelque chose de clair et franc, riche d’attention et de compréhension, répandant la lumière. » Les riches qualités humaines qu’elle déploie font qu’il en tombe amoureux. Sur le point de quitter l’Irlande pour ses affaires, il la demande en mariage. Sa surprise est grande d’entendre Edel répondre qu’elle ne peut accepter, car elle s’est promise à Dieu. En effet, la jeune fille a perçu dès son jeune âge un appel à la vie religieuse contemplative. Toutefois, craignant que son refus ait des répercussions négatives sur la vie spirituelle de son prétendant, elle reste quelque temps en correspondance avec lui, par des lettres amicales qui lui font un grand bien.
En attendant de réaliser sa vocation, elle se détend en jouant au golf ou en faisant de la musique. Mais elle délaisse peu à peu ces légitimes plaisirs au profit du dévouement, pour aider sa mère à la maison, les pauvres et les malades. Le dimanche est vraiment pour elle le jour du Seigneur. Elle assiste le matin à plusieurs Messes et approfondit sa foi, de telle sorte que sa formation chrétienne s’étend largement. Sa soif de prière et de recueillement est intense. Bien souvent pourtant, elle prend du temps pour aider ses amis, en les écoutant avec sympathie. Dès 1927, à l’âge de vingt ans, en attendant de savoir dans quelle communauté devenir religieuse, elle rejoint la Légion de Marie, association fondée par Frank Duff (1889-1980), un employé d’un ministère de l’État (son procès de béatification a été introduit). Celui-ci n’avait pensé fonder qu’un groupe de quelques personnes ; mais son initiative locale s’étendra à la dimension du monde. Lui-même sera appelé à parler en présence des évêques du monde entier au cours du concile Vatican II. La soumission au Magistère de l’Église est, pour les légionnaires, un principe fondamental. Ils participent à la vie de leur paroisse en collaborant à toutes ses activités, particulièrement la visite des familles et des malades, tant à domicile que dans les hôpitaux. Chaque légionnaire doit accomplir un travail apostolique hebdomadaire.
Lors d’une réunion des Enfants de Marie, dont elle fait partie, Edel se lie d’amitié avec une jeune légionnaire qui la présente à la responsable ainsi qu’à l’aumônier. Enthousiasmée, Edel demande à être admise dans le mouvement, ce qui lui est accordé. Bientôt, dépassant ce qui est prescrit, elle visite des personnes dans le besoin cinq soirs par semaine. Après deux ans de service comme membre actif ordinaire, elle devient responsable d’un groupe qui s’occupe des filles perdues. Deux soirs par semaine, elle se rend à la maison établie pour des converties, Sancta Maria, où elle exerce son don de sympathie rayonnante. Aussi est-elle joyeusement accueillie par les pensionnaires qui voudraient ne pas la laisser repartir.
Ma plus grande joie
La forte et exigeante spiritualité franciscaine des Clarisses attire Edel. En 1932, alors que son projet d’entrer chez ces religieuses à Belfast prend forme, elle tombe malade de la tuberculose, à l’époque pratiquement incurable. « Tout ce qui arrive est adorable » c’est-à-dire est permis par Dieu, dit-elle. On l’envoie dans un sanatorium où elle continue sa vie de dévouement et de mortification, gaiement et au service de tous. Elle lit beaucoup d’ouvrages spirituels, et tout spécialement les écrits de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Après dix-huit mois, qui lui semblent longs, elle rentre chez elle, désarmant par son sourire les objections de ceux qui auraient souhaité qu’elle prolonge son repos. Poursuivant pendant quelques mois les prescriptions médicales, elle reprend son travail professionnel et de dévouement à la Légion. L’expansion de celle-ci est encore lente à cette époque. Elle ne s’étend au-delà de Dublin qu’en 1927, et de l’Irlande qu’en 1928 pour commencer en Écosse. Mais dès cette même année, le rythme s’accélère. En 1930, la Légion s’implante en Inde, puis en Amérique l’année suivante. En 1934, un pèlerinage légionnaire est organisé à Lourdes ; Edel s’y joint. À son retour, elle est envoyée avec quelques compagnes, comme fondatrice au pays de Galles : rencontres, conférences, visites diverses, spécialement aux évêques : un travail harassant pendant quinze jours, qui porte de grands fruits. Paradoxalement, elle revient en Irlande en meilleure santé. Pendant ce temps, des groupes naissent en Afrique. En 1936, Edel part comme missionnaire de la Légion de Marie en Afrique centrale et orientale. Une forte opposition s’est pourtant dressée contre cette mission, au Conseil supérieur de la Légion, mais la bonne grâce d’Edel et sa réputation, avec l’aide du Saint-Esprit, ont triomphé de tout. « Souffrir pour l’amour de Jésus-Christ est ma plus grande joie », écrit-elle.
Gagner les cœurs
La première lettre d’Edel pendant le voyage est pour remercier ceux qui l’ont envoyée, malgré les risques dont elle est bien consciente. Le 23 novembre, on parvient au port kenyan de Mombasa, colonie britannique, où l’influence musulmane est très forte. Edel se rend tout de suite à la capitale du pays, Nairobi, où elle prend contact avec les principaux catholiques du lieu, parmi lesquels se trouvent quelques légionnaires. Elle écoute, sans se laisser décourager par les objections, organise une conférence de présentation et, le 15 décembre, le premier groupe est fondé ; le Père Maher, supérieur des missions de la région, en devient le directeur spirituel. Edel s’applique à fondre son apostolat dans celui des missionnaires, espérant ainsi les gagner à sa cause. Les débuts sont souvent ardus, mais son union à Dieu et sa gentillesse permettent de gagner bien des cœurs. Elle traite les prêtres avec un grand respect. À son contact, les préjugés tombent, chez les européens et parmi les indigènes africains. Si elle se montre inflexible pour les principes généraux exposés dans le Manuel du Légionnaire, pour les détails pratiques, en revanche, sa facilité d’adaptation aux conditions de l’Afrique équatoriale s’avère remarquable : elle perçoit et respecte les rythmes africains sans rien brusquer. Confrontée aux déceptions et aux échecs, elle ne baisse pas les bras. Elle parvient à apaiser bien des hostilités entre ethnies, et à assouplir certaines traditions sur le rôle des femmes considéré comme uniquement domestique.
L’évangélisation est une priorité pour la Légion. Par la visite des foyers et par d’autres moyens, est établi un contact avec chaque personne. Voir et servir le Christ dans les malades et les marginalisés est une autre partie essentielle de l’apostolat légionnaire.
L’unité de base de la Légion s’appelle un praesidium ; il est normalement basé sur une paroisse, qui peut d’ailleurs en avoir plusieurs. Pour devenir un légionnaire actif, il est nécessaire de demander son intégration dans un praesidium. Lors des réunions hebdomadaires, on attribue une tâche aux membres, qui travaillent généralement en binômes. Après une période de probation réussie, les membres font la promesse légionnaire. Consciente de la nécessité du soutien de la grâce, la Légion compte des membres auxiliaires qui s’y associent par la prière. L’administration de la Légion s’effectue à travers ses différents conseils aux niveaux local, régional et national.
En dépit de sa santé déficiente, Edel montre une surprenante résistance à la fatigue et à la chaleur. Une religieuse qui l’a connue alors dira : « C’était la personne la plus oublieuse d’elle-même ! » Grâce à son dévouement, des centaines de groupes de la Légion de Marie sont implantés au Kenya, renforçant l’évangélisation en profondeur. Elle apprend un peu le swahili et des bribes de plusieurs autres dialectes. L’organisation de la Légion, avec ses apostolats deux à deux et les rapports hebdomadaires, prospère à merveille, en particulier grâce au dynamisme de la jeune missionnaire omniprésente, qui suit attentivement chaque groupe, mais se tient aussi au courant des progrès de la Légion en Europe, en Amérique et jusqu’en Chine. Edel organise des réunions régionales périodiques et fonde à Nairobi un quartier général. Elle entretient une correspondance abondante, tant avec les groupes qu’elle a fondés, les évêques et les missionnaires locaux qu’avec ses amis de Dublin.
Simplement unie à Lui
Elle obtient que certains groupes soient fondés par les indigènes eux-mêmes, et fait ainsi accepter aux Africains de devenir les évangélisateurs de leurs compatriotes, ce qui, auparavant, était exclusivement la tâche des missionnaires et des catéchistes. Elle lutte également avec succès contre l’indolence habituelle des autochtones, l’hostilité des sorciers, les difficultés de communications, surtout en saison de pluie. Elle veille à garder des moments de recueillement, même pendant les voyages : « Être simplement unie à Lui, en union avec Marie. Juste l’aimer dans mon âme pendant le jour en voyage, unissant mes actions à des actions semblables qu’Il a faites. » Dans l’une de ses prières favorites, elle demande : « Accordez-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l’étendard de Marie, cette plénitude de foi en Vous et de confiance en elle, qui sont assurés de vaincre le monde. Donnez-nous une foi vive et animée par la charité ! » (cf. Ga 5, 6).
La Messe reste le centre de sa vie. En une occasion, elle demeure à jeun pendant dix-sept heures pour pouvoir recevoir la sainte Communion. Edel attribue au Saint-Sacrement son extraordinaire résistance : « Comme la vie serait vide sans Lui ! » écrit-elle. Son amour intense pour la Mère de Dieu, sa confiance d’enfant et sa complète dépendance envers Elle sont des traits dominants de sa vie. Un jour, on lui demande si elle a jamais refusé quelque chose à Notre-Dame : « Non, répond-elle, je ne lui ai jamais rien refusé de ce que je pensais lui tenir à cœur. » La spiritualité de la Légion est centrée sur la dévotion au Saint-Esprit et à la Vierge Marie. Franck Duff s’est beaucoup inspiré du “Traité de la Vraie dévotion à la Sainte Vierge” de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Ce saint y montre bien que Marie conduit à Jésus : « C’est par la Très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c’est aussi par elle qu’il doit régner dans le monde… » (n°1). Parmi les qualités de la vraie dévotion à Marie, il souligne : « La vraie dévotion à la Sainte Vierge porte une âme à éviter le péché et imiter les vertus de la Très Sainte Vierge, particulièrement son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance, son oraison continuelle, sa mortification… ; elle affermit une âme dans le bien, et elle la porte à ne pas quitter facilement ses pratiques de dévotion ; elle la rend courageuse à s’opposer au monde, dans ses modes et maximes, à la chair, dans ses ennuis et ses passions ainsi qu’au diable, dans ses tentations ; en sorte qu’une personne vraiment dévote à la Sainte Vierge n’est point changeante, chagrine, scrupuleuse ni craintive… Un vrai dévot l’aime et la sert aussi fidèlement dans les dégoûts et sécheresses que dans les douceurs et ferveurs sensibles ; il l’aime autant sur le Calvaire qu’aux noces de Cana. Oh ! qu’un tel dévot de la Sainte Vierge est agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa Sainte Mère ! » (nos 108, 110).
« Ils ne sont pas prêts »
En 1937, Mgr Riberi, le nonce apostolique des missions africaines, écrit une lettre aux trente-trois évêques dont il est chargé, pour leur vanter la Légion. Il y recommande Edel et son action. Celle-ci exprime sa gratitude pour ce geste, en profite pour élargir son apostolat et forme le projet de se rendre en Ouganda, pays où les traditions ancestrales sont encore plus difficiles à vaincre qu’au Kenya. On lui affirme que les gens ne sont pas prêts à recevoir l’Évangile. Consciente de la brièveté de la vie, de la sienne en particulier, elle ne se laisse pas arrêter, et parvient à fonder dans ce pays de multiples groupes fervents, à la grande joie des missionnaires qui apprécient cette aide précieuse.
En 1938, Edel est atteinte de la malaria. Les médecins lui prescrivent du repos. Pour la première fois, cette malade chronique s’avoue vaincue et elle prend quelques semaines au calme, restant pourtant discrète sur ce sujet dans ses lettres à Dublin pour ne pas alarmer ses supérieurs. Malgré cette précaution, l’information leur parvient, et ils l’invitent à venir se reposer en Irlande pour y refaire sa santé. Avec politesse, elle décline l’offre. En septembre 1939, la guerre se déclare en Europe et certains envisagent le pire en Afrique. Edel écrit dans ses notes intimes : « Quelle confiance sans limite nous devons avoir en l’amour divin. Nous ne pouvons pas trop aimer. La faiblesse qu’Il nous laisse ne doit pas nous empêcher de faire notre travail… En ce qui concerne mon travail, c’est maintenant qu’il va commencer à être vraiment utile : la guerre va empêcher que l’on envoie de nouveaux missionnaires. »
En janvier 1940, à la demande de l’archevêque de Port-Louis, Mgr Leen, elle se rend à l’Île Maurice en dépit des risques liés à la présence de sous-marins allemands et de mines flottantes. En cinq mois, grâce aux recommandations du prélat et à l’aide des curés et des missionnaires, elle fonde vingt groupes, comptant près de trois cents légionnaires actifs, et un organe central, puis elle repart pour le continent africain. On peut affirmer qu’elle a aimé l’Île Maurice et s’en est fait aimer, comme dans tous les pays où elle a séjourné. Le P. Margeot, directeur spirituel de la Légion pour l’île, dira : « Mlle Quinn était une âme à la simplicité étonnante. Elle avait réalisé une très grande unité intérieure et semblait totalement abandonnée à la volonté de Dieu. » À l’archevêque, il confiera qu’il aimerait, le moment venu, témoigner à son procès de canonisation.
En Tanzanie, où elle arrive en septembre 1940, très fatiguée du voyage rendu plus long du fait de la guerre, elle se met aussitôt au travail. Nul ne prend conscience de la fatigue qui l’accable, car elle répond à toutes les sollicitations. Mais, en mars 1941, elle télégraphie à Dublin : « Attaque pleurésie. Très faible. Poids : trente-quatre kilos. Impossible continuer travail. À présent, repos considérable nécessaire. Attends instructions. » La réponse arrive : « Faites comme vous croyez ! » Un médecin lui affirme qu’après tant de temps passé sous les tropiques, il est indispensable qu’elle se rende en pays subtropical pour refaire sa santé ; elle se décide pour Johannesburg, en Afrique du Sud. Désormais, elle fréquente surtout les sanatoriums et prend un repos relatif dans des communautés religieuses. Les six premiers mois, elle reste alitée, mais intensifie sa vie spirituelle, en particulier par la dévotion eucharistique. Malgré les consignes de Dublin, elle continue sa volumineuse correspondance. Six mois après son arrivée, Edel entre dans un hôpital tenu par des Sœurs dominicaines, où elle pourra communier tous les jours. Sa bonne humeur et sa gentillesse la font aimer de tous. Malgré son extrême maigreur, elle est extraordinairement animée et gaie. À l’automne de 1942, ayant obtenu la permission des médecins, elle retourne à Nairobi. Le voyage, rendu compliqué par la guerre, prendra presque trois mois. Elle loge dans un couvent, mais reprend son œuvre autant que ses forces le lui permettent, assistant aux réunions des groupes du Kenya, et écrivant beaucoup de lettres. Sa gaieté parvient à cacher un peu son état.
Au début de 1944, elle est à nouveau contrainte au repos complet, auprès d’une communauté de Sœurs irlandaises. Elle continue à faire des plans d’expansion pour l’avenir, que d’autres réaliseront. Son dernier voyage lui permet de rester un peu plus d’un mois à Kisumu, sur le lac Victoria, à dix-huit heures de train. Revenue plus morte que vive, le 11 avril, elle reprend le travail à Nairobi. Malgré l’aggravation de son état, elle refuse de faire appeler le médecin : « Je ne veux pas faire d’histoires ! » Son dernier rapport à Dublin, posté le 4 mai, n’y parviendra qu’après sa mort. « À l’égard de Marie, avoir l’attitude d’un enfant envers sa mère. Avoir confiance qu’elle fera ce qu’il y a de mieux », avait-elle écrit jadis. Dans de telles dispositions, elle reçoit les derniers sacrements, gardant assez de conscience pour s’associer intérieurement aux prières. Après huit ans de travail en Afrique, Edel Quinn meurt à Nairobi, au couvent des Sœurs du Précieux Sang, en murmurant le Saint Nom de Jésus, le 12 mai 1944, âgée de trente-sept ans.
Heureux, mille fois heureux !
L’âme du vrai dévot à Marie, écrit saint Louis-Marie Grignion de Montfort, « recourt à elle en tous ses besoins de corps et d’esprit, avec beaucoup de simplicité, de confiance et de tendresse ; elle implore l’aide de sa bonne Mère dans ses doutes, pour être redressée ; dans ses tentations, pour être soutenue ; dans ses faiblesses, pour être fortifiée ; dans ses chutes, pour être relevée ; dans ses découragements, pour être encouragée ; dans ses scrupules, pour en être ôtée ; dans ses croix, travaux et traverses de la vie, pour être consolée… Heureux donc et mille fois heureux les chrétiens qui, maintenant, s’attachent fidèlement et entièrement à Marie comme à une ancre ferme. Les effets de l’orage de ce monde ne les feront point submerger, ni perdre leurs trésors célestes. Heureux ceux et celles qui entrent en elle comme dans l’arche de Nœ ! Les eaux du déluge de péchés, qui noient tant de monde, ne leur nuiront point, car : Qui operantur in me non peccabunt : Ceux qui sont en moi pour travailler à leur salut ne pécheront point, dit-elle avec la Sagesse (Si 24, 30) » (Ibid., n°175).
Demandons à la vénérable Edel Quinn de nous obtenir la grâce de puiser dans le Cœur de la Vierge Marie, Mère de l’Église, une grande sollicitude pour la destinée éternelle des hommes de notre temps, rachetés par le Sang de son Fils !