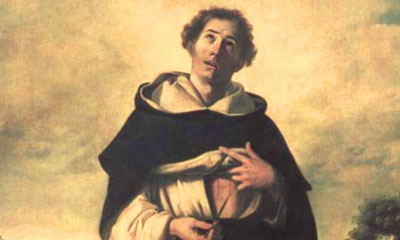12 juin 2024
Sainte Philippine Duchesne
Bien chers Amis,
« Aujourd’hui, écrivait le Pape saint Jean-Paul II, l’appel à la conversion que les missionnaires adressent aux non-chrétiens est mis en question ou passé sous silence. On y voit un acte de “prosélytisme” ; on dit qu’il suffit d’aider les hommes à être davantage hommes ou plus fidèles à leur religion, qu’il suffit d’édifier des communautés capables d’œuvrer pour la justice, la liberté, la paix, la solidarité. Mais on oublie que toute personne a le droit d’entendre la Bonne Nouvelle de Dieu, qui se fait connaître et qui se donne dans le Christ, afin de réaliser pleinement sa vocation » (Redemptoris missio, 7 décembre 1990, n°46). En canonisant sainte Rose-Philippine Duchesne, le 3 juillet 1988, le même Pape présentait un exemple de zèle missionnaire. Au xixe siècle, cette sainte religieuse a contribué à la mission de l’Église en Amérique du Nord.
 Rose-Philippine Duchesne est née à Grenoble le 29 août 1769. Elle est fille de Pierre-François Duchesne, avocat au Parlement du Dauphiné, et de Rose-Euphrasine Perier. Par sa mère, elle appartient à une famille très fortunée. Au Baptême, l’enfant est placée sous le patronage de sainte Rose de Lima, première sainte des Amériques, et de l’apôtre saint Philippe. Dès son enfance, la petite fille fait preuve de la raideur et de la ténacité du caractère Duchesne, qu’elle s’efforcera d’assouplir par des efforts persévérants. Toutefois, elle sait s’oublier elle-même pour se dévouer aux autres. Elle affirme : « Le plus grand de mes plaisirs, c’est de faire du bien ! » Pleine de désirs pour ce qui est grand et généreux, elle conçoit une grande estime pour les missions : « Ma première estime pour l’état missionnaire, écrira-t-elle, vint des conversations d’un bon Père jésuite qui avait fait les missions de la Louisiane… Je n’avais que huit ou dix ans, et néanmoins, j’estimais heureux les missionnaires. »
Rose-Philippine Duchesne est née à Grenoble le 29 août 1769. Elle est fille de Pierre-François Duchesne, avocat au Parlement du Dauphiné, et de Rose-Euphrasine Perier. Par sa mère, elle appartient à une famille très fortunée. Au Baptême, l’enfant est placée sous le patronage de sainte Rose de Lima, première sainte des Amériques, et de l’apôtre saint Philippe. Dès son enfance, la petite fille fait preuve de la raideur et de la ténacité du caractère Duchesne, qu’elle s’efforcera d’assouplir par des efforts persévérants. Toutefois, elle sait s’oublier elle-même pour se dévouer aux autres. Elle affirme : « Le plus grand de mes plaisirs, c’est de faire du bien ! » Pleine de désirs pour ce qui est grand et généreux, elle conçoit une grande estime pour les missions : « Ma première estime pour l’état missionnaire, écrira-t-elle, vint des conversations d’un bon Père jésuite qui avait fait les missions de la Louisiane… Je n’avais que huit ou dix ans, et néanmoins, j’estimais heureux les missionnaires. »
Philippine est mise en pension chez les Sœurs de la Visitation, ordre monastique fondé en 1610 par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Les Sœurs sont cloîtrées, mais elles tiennent des écoles pour jeunes filles. Une de ces écoles, Sainte-Marie-d’en-Haut, se trouve à Grenoble. La foi jette alors de profondes racines dans l’âme de Philippine, et la crainte de Dieu lui fait fuir tout ce qui pourrait offenser le regard divin. L’amour du Cœur de Jésus s’imprime dans son âme. De nombreuses peintures et inscriptions que l’on voit au monastère traduisent ces fortes paroles de saint François de Sales : « Dans la sainte Église de Dieu, tout appartient à l’amour, tout est fondé sur l’amour, tout aboutit à l’amour et tout est amour. Dieu, qui a créé l’homme à son image, veut qu’en l’homme, comme en Dieu, tout soit ordonné par l’amour et pour l’amour. »
À l’âge de douze ans, la jeune fille fait sa première Communion. Elle perçoit alors l’appel à se donner tout à Jésus dans la vie religieuse et devient très fervente. « Dès lors, rapporte sa sœur, elle ne regarda plus le monde que comme un lieu d’exil, et la vie religieuse lui parut la seule capable de répondre au désir de son âme. » Apprenant ce désir de leur fille, ses parents la reprennent chez eux et l’introduisent dans la vie mondaine ; mais au milieu des concerts et de la danse, où elle se montre à l’aise, Philippine pense à réaliser sa vocation. À la maison, elle s’occupe des mendiants qui se présentent à la porte, tout en continuant ses études. Elle s’applique en particulier au latin pour mieux comprendre la Sainte Écriture. Parvenue à l’âge de dix-sept ans, elle refuse un mariage avantageux qu’on lui propose, puis renonce à toute mondanité. Un an après, en 1787, Philippine entre au couvent de la Visitation, malgré l’opposition de ses parents. Le désir d’exercer un jour la fonction d’éducatrice de la jeunesse dans les pensionnats lui a fait préférer la Visitation au Carmel qu’elle aimait pourtant beaucoup. Elle édifie ses Sœurs par son amour inconditionnel de Jésus et par la vivacité de sa charité. Le soir, après une journée bien remplie, elle veille, moyennant la permission de ses supérieures, et prie longuement dans la nuit. À l’issue de son noviciat, la permission de prononcer ses vœux de religion lui est refusée par son père, qui demande qu’elle attende d’avoir vingt-cinq ans ; il lui permet cependant de demeurer au couvent. Sur le conseil d’un prêtre prudent, elle se soumet.
En 1789, la Révolution éclate en France ; dès 1791, les Visitandines de Grenoble sont dispersées et leur couvent fermé. Philippine revient vivre en famille dans un domaine des Duchesne situé dans la Drôme. Elle se dévoue auprès de prisonniers et de prêtres réfractaires. À la fin de la tourmente révolutionnaire, en 1801, sollicitée de s’occuper d’enfants abandonnés ou orphelins, Philippine loue l’ancien couvent de Sainte-Marie-d’en-Haut ; elle s’y installe avec quelques enfants et invite les religieuses visitandines expulsées à y revenir. Quelques anciennes Sœurs reviennent, mais il s’avère impossible de rétablir la vie religieuse. Entendant alors parler de Madeleine-Sophie Barat (1779-1865) qui vient de fonder en 1802 à Amiens les Dames du Sacré-Cœur, elle s’offre à elle, avec sa maison. Mme Barat accepte et se rend à Sainte-Marie en 1804 avec trois de ses religieuses. Après un bref noviciat, Philippine Duchesne prononce ses premiers vœux de religion en 1805, à l’âge de trente-six ans. La Société du Sacré-Cœur étant vouée à l’enseignement, la maison de Sainte-Marie est transformée en un pensionnat.
Une nuit dans le nouveau continent
En 1806, Dom Augustin de Lestrange, abbé du monastère cistercien de la Trappe, est invité à prêcher à la communauté. Impressionnée par l’évocation de la mission d’Amérique du Nord d’où revient le prédicateur, Philippine ressent à nouveau l’appel à partir en mission. Au cours de la nuit d’adoration eucharistique du Jeudi Saint, elle reçoit une grâce particulière, qu’elle confie à Mère Barat : « Toute la nuit, j’ai été dans le nouveau continent… Je portais partout mon trésor (le Saint-Sacrement)… J’avais bien à faire aussi avec tous mes sacrifices à offrir : une mère, des sœurs, des parents, une montagne… Quand vous me direz : “Voici que je vous envoie”, je répondrai vite : “Je pars.” » Pendant douze ans, Mère Sophie la façonne patiemment pour en faire une religieuse missionnaire accomplie. Elle l’encourage à la douceur : « Vous qui aimez tant le bon François de Sales, lui écrit-elle, pourquoi n’avez-vous pas pris de son esprit, quand vous étiez à son école ? Quelle douceur apprenait-il à avoir avec soi-même et avec tout le monde ! » À la fin de 1815, Philippine se rend à Paris pour un conseil général de la Société. Elle est promue secrétaire générale, et on lui confie la charge de fonder une communauté dans la ville, rue des Postes. En janvier 1817, Mgr Guillaume-Valentin Dubourg, premier évêque de la Louisiane, s’y présente et demande des religieuses pour l’éducation des jeunes filles dans son diocèse (la Louisiane de l’époque est un très vaste territoire qui s’étend des Grands Lacs d’Amérique du Nord au golfe du Mexique au sud, le long du fleuve Mississippi, lequel a une longueur de plus de 3700 km). Philippine est prête à partir.
Une douce idée
En 1818, nommée supérieure de toutes les maisons qui seront fondées en Amérique, Mère Philippine se rend à Bordeaux avec quatre religieuses. L’appareillage pour le Nouveau Monde a lieu le 21 mars. Après soixante-dix jours d’un voyage rendu pénible par les tempêtes, on parvient à La Nouvelle-Orléans, en la fête du Sacré-Cœur. Le premier mouvement de la Mère Duchesne est de se mettre à genoux et de baiser la terre, les yeux baignés de larmes. Après quarante-deux jours supplémentaires de voyage pour remonter le cours du Mississippi, en bâteau à vapeur à roues, les cinq religieuses parviennent enfin à Saint-Louis, modeste bourgade de six mille habitants, fondée par les Français en 1764, située environ 1000 km plus au nord. Mgr Dubourg les accueille très chaleureusement. Puis elles passent à Saint-Charles, à quelques kilomètres de là, l’une des deux plus anciennes villes à l’ouest du Mississippi, fondée en 1765. Là, les Sœurs ouvrent la première maison de la congrégation hors d’Europe. Ce n’est qu’une cabane en bois, et les religieuses sont soumises à toutes les austérités d’une vie de pionnières : le froid extrême, la dureté du travail, le manque d’argent, la lenteur du courrier entre l’Amérique et la France. Mère Philippine éprouve, de plus, beaucoup de difficulté à apprendre l’anglais. L’établissement est double : pensionnat et école gratuite pour les jeunes filles pauvres. Mais la pénurie, la faim et le manque d’élèves contraignent les religieuses à fermer l’un et l’autre dès l’année suivante. « Nous nous faisions jadis une douce idée d’instruire les filles du pays dociles et innocentes, mais la paresse et l’ivrognerie atteignent les femmes comme les hommes… », écrit Mère Philippine avec nostalgie.
L’Église catholique aux États-Unis n’est pas florissante. Les immigrés sont souvent des aventuriers dépourvus de sens moral. Les Jésuites, rétablis par le Pape Pie VII en 1815, se développent rapidement, mais ils se bornent à fonder des collèges de garçons sur la côte atlantique. Pour les filles, il n’existe pas d’établissement d’éducation. Le régime de l’esclavage existe encore dans la société, et les religieuses, ne pouvant elles-mêmes abolir cette institution inhumaine, emploient des esclaves pour leurs différents travaux. Pourtant, dira le concile Vatican II, l’Évangile « annonce et proclame la liberté des enfants de Dieu, rejette tout esclavage qui en fin de compte provient du péché, respecte scrupuleusement la dignité de la conscience et son libre choix, enseigne sans relâche à faire fructifier tous les talents humains au service de Dieu et pour le bien des hommes, enfin confie chacun à l’amour de tous » (Gaudium et spes, n° 41).
Invitées par Mgr Dubourg, Mère Duchesne et ses religieuses traversent le fleuve et arrivent en plein hiver à Florissant. Cette commune, au confluent du Mississippi et du Missouri, ressemble à un village français. L’évêque a choisi d’y résider pour être plus proche des tribus amérindiennes. Une ferme est mise à la disposition des Sœurs. Bientôt des élèves se présentent. Une chapelle est construite pour la fête de Nœl 1819. Des postulantes entrent dans la communauté, et Mère Philippine ouvre sans attendre un noviciat. Elle propage le culte du Sacré-Cœur. Sous son influence, l’évêque dédie au Sacré-Cœur l’église qu’il fait construire à Florissant. Mère Sophie Barat avait dit à ses filles en partance pour l’Amérique : « Quand vous ne feriez dans ce pays qu’élever un seul autel au Sacré-Cœur de Jésus, c’en serait assez pour le bonheur de votre éternité ! » Des conversions ont lieu parmi les Algonquins et les Osages ; les Iroquois, influencés par les protestants anglais, ne sont pas accessibles.
Des élèves récalcitrantes
Un vaste terrain est offert en 1821 par une riche veuve, à Grand Coteau près de La Nouvelle-Orléans. Mère Philippine s’y rend et installe un pensionnat où s’inscrivent dix-sept jeunes filles. Cette fondation va permettre de recevoir les filles des familles fortunées de La Nouvelle-Orléans. La Mère revient ensuite à Florissant où le travail est difficile car les élèves sont récalcitrantes et peu portées à la régularité. En 1823, arrive un groupe de onze jésuites belges, dont le Père De Smet, qui considérera Mère Philippine comme « la plus grande sainte du Missouri et sans doute de tous les États d’Amérique ». Sous la direction du Père Van Quickenborne, ces prêtres donnent une grande impulsion à la mission du Missouri. D’autres congrégations missionnaires, gagnées par l’enthousiasme de Mgr Dubourg, s’installent également dans la région, tels les Lazaristes.
Croire ou ne pas croire en Jésus-Christ n’est pas indifférent. À qui ne connaît pas le Seigneur, il manque une vérité essentielle. « Parfois, écrit le Pape François, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant que l’Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes » (Exhortation Evangelii gaudium, 2013, n°265).
« Aujourd’hui, affirmait le Pape saint Jean-Paul II, la tentation existe de réduire le christianisme à une sagesse purement humaine, en quelque sorte une science pour bien vivre. En un monde fortement sécularisé, est apparue une “sécularisation progressive du salut”… on se bat pour l’homme, certes, mais pour un homme mutilé, ramené à sa seule dimension horizontale. Nous savons au contraire que Jésus est venu apporter le salut intégral qui saisit tout l’homme et tous les hommes, en les ouvrant à la perspective merveilleuse de la filiation divine… Tout homme a besoin de Jésus-Christ, lui qui a vaincu le péché et la mort et réconcilié les hommes avec Dieu… L’Église ne peut se dispenser de proclamer que Jésus est venu révéler le visage de Dieu et mériter, par la Croix et la Résurrection, le salut pour tous les hommes » (Redemptoris missio, n°11). C’est pourquoi, annoncer le Christ par le témoignage de la vie et par la parole incombe à tout fidèle (cf. Catéchisme de l’Église catholique, nos904-905). « Il n’y a pas moyen d’être chrétien sans embrasser le monde dans son ambition, sans désirer ardemment le jour où le Christ ramassera tous les hommes sous l’invocation de son Nom » (Père Lacordaire – 1802-1861, Lettre à un jeune homme).
L’abbé Delacroix, curé d’une paroisse proche de La Nouvelle-Orléans fait de nouveau appel, en 1826, à Mère Duchesne pour réaliser une fondation à Saint-Michel, non loin de la grande ville. Cette fondation se fait dans des conditions de grande pauvreté et de confiance extraordinaire en la Providence divine. En 1827, Mère Philippine reprendra un établissement des Filles de la Croix à Bayou-la-Fourche, non loin de Saint-Michel, avec les neuf religieuses de la maison et les neuf pensionnaires.
Douloureuse solitude
En 1827 également, une maison est offerte par le curé de Saint-Louis. Mère Philippine y ouvre un orphelinat, un pensionnat et une école externe. Mais Mgr Dubourg, le grand soutien de la Mère, aux prises depuis longtemps avec d’innombrables difficultés, abreuvé d’amertumes, victime de trahisons, rentre en France où il est nommé évêque de Montauban. La Mère ressent très douloureusement ce départ qui la laisse dans un grand sentiment de solitude : « Nous n’avons plus aujourd’hui d’ami zélé que Jésus, écrit-elle, tout autre appui languit et s’éloigne de nous. » En octobre 1828, à la demande des Jésuites, l’école de Saint-Charles reprend vie. Six maisons s’échelonnent maintenant dans la vallée du Mississippi. Mère Philippine est reconduite comme supérieure des maisons de la congrégation du Sacré-Cœur en Louisiane. Elle a soixante ans, et sa santé est souvent déficiente. De plus, elle se croit incapable. Elle écrit à Mère Barat, au printemps 1829 : « Pour moi, je ne suis plus qu’un bâton usé, et bon à jeter au premier jour… Tout va mal entre mes mains. Je me vois comme un vieux lion qui n’a plus aucun moyen d’agir, et que tout accable et pique. »
En 1834, elle est à Florissant. Ses responsabilités ne l’empêchent pas de passer souvent ses nuits près des malades. Elle accomplit aussi des tâches de la vie quotidienne comme la réparation des vêtements, le soin de la basse-cour et du jardin, sans pourtant délaisser l’instruction religieuse. Les enfants reconnaissent : « Elle nous rendait vivantes et réelles les vérités divines. » Mais avant tout, elle respecte la priorité de l’Office divin. À peine a-t-elle entendu la cloche qui annonce l’Office qu’elle se rend à la chapelle avec recueillement. L’amour qu’elle manifeste pour sa congrégation est intense. Lors de la récréation, elle raconte aux jeunes Sœurs les débuts de l’institut et les œuvres de la sainte Mère Madeleine-Sophie Barat aux temps héroïques en France.
En 1840, une nouvelle supérieure générale est nommée pour les missions d’Amérique. Déchargée de toute responsabilité, Mère Philippine retourne à Saint-Louis pour se consacrer davantage à la prière. En 1841, elle obtient l’autorisation d’effectuer avec trois compagnes une fondation, souhaitée par le Père De Smet, chez les Potawatomis, peuple autochtone de la région du Haut-Mississipi déplacé de force vers l’ouest, et partiellement converti. Plusieurs objectent le délabrement de la santé de Mère Philippine, mais le Père jésuite qui dirige la mission insiste : « Elle doit venir ! Elle n’est plus capable de beaucoup de travail, mais elle assurera le succès de la mission par sa prière. Sa présence attirera toutes sortes de faveurs divines sur nos travaux. » Une centaine d’Indiens à cheval accueillent la Mère avec enthousiasme. Ils lui font une garde d’honneur jusqu’à la maison de la Mission Sainte-Marie de Sugar Creek, fondée en mars 1839 par les Jésuites, sous la forme d’une école pour les Potawatomis et d’une exploitation agricole.
De saints Amérindiens
« Il y a là, rapportera Mère Philippine, des métis qui sont des saints. Il y en a aussi parmi les “sauvages”. On voit dans cette mission ce qui ne se voit point ailleurs, tant la foi qui y règne rappelle les premiers temps de l’Église… Une fois baptisés, les anciens païens ne connaissent plus l’ivrognerie, ni le vol, ni le brigandage… Les Potawatomis s’assemblent le matin pour la prière en commun, la Messe et l’instruction ; ils font de même ensemble la prière du soir. » La supérieure locale rapporte que par deux fois la sainte Hostie, s’échappant des mains du prêtre, était allée d’elle-même se placer sur les lèvres d’une pauvre femme. Mère Duchesne observe que le christianisme transforme non seulement l’âme des indigènes mais aussi les traits de leur physionomie. Une femme amérindienne racontait qu’elle avait été instruite de la religion par la Sainte Vierge elle-même qu’elle voyait souvent, et les vertus sublimes de sa vie et de sa mort confirmèrent la sincérité de son naïf témoignage. Un bon “Indien” avait entendu son ange gardien lui apprendre tout au long l’histoire de la Passion du Christ. Bientôt, la dévotion aux Cœurs de Jésus et de Marie s’étend à la nation des Têtes-Plates. Mais d’autres tribus du voisinage restent encore livrées à la pratique du cannibalisme.
Passés toutefois les premiers moments de joie, l’évangélisation s’avère difficile. Le courage de la Mère ne diminue pourtant pas, et ses longues heures de prière contemplative amènent les Amérindiens à la nommer « la femme qui prie toujours ». « Seigneur, Toi seul es le Centre dans lequel je trouve le repos, dit-elle à Jésus. Donne-moi Ton bras pour me soutenir, Tes épaules pour me porter, Ta poitrine pour m’appuyer, Ta Croix pour me soutenir, Ton Corps pour me nourrir. En Toi, Seigneur, je dors et je me repose en paix. » Il lui faut toutefois renoncer à pouvoir jamais se faire entendre dans la langue indienne : « Elle est difficile et tout à fait barbare. Des mots interminables de huit à dix syllabes, point de dictionnaire, point de grammaire, pas de livre… Je ne crois pas pouvoir apprendre une telle langue ! » Sa santé ne résiste pas longtemps à la rude vie et au climat glacé du lieu, et dès juillet 1842, elle regagne Saint-Charles. Là, son apostolat par la prière édifie et encourage ses Sœurs et les élèves. Elle reçoit dans l’Eucharistie de grandes grâces qui transparaissent au-dehors. Elle meurt à Saint-Charles le 18 novembre 1852 vers midi, en murmurant les noms de Jésus, Marie et Joseph. Elle a quatre-vingt-trois ans.
« L’activité missionnaire représente aujourd’hui encore le plus grand des défis pour l’Église, écrivait le Pape saint Jean-PaulII… Il devient toujours plus évident que les nations qui n’ont pas encore reçu la première annonce du Christ constituent la majeure partie de l’humanité… Tous ceux qui croient au Christ doivent éprouver, comme partie intégrante de leur foi, le zèle apostolique de transmettre aux autres la joie et la lumière de la foi. Ce zèle doit devenir pour ainsi dire une faim et une soif de faire connaître le Seigneur, dès lors que le regard se porte sur les horizons immenses du monde non chrétien » (Encyclique Redemptoris missio, n° 40). L’exemple et l’intercession auprès de Dieu de sainte Rose-Philippine Duchesne nous aideront à annoncer le Christ, là où le Seigneur nous a placés.