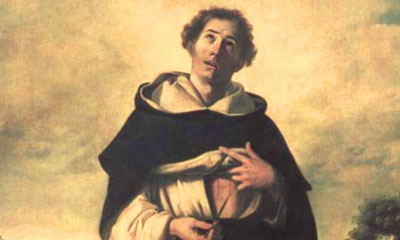4 décembre 2024
Bienheureux José Hernandez Cisteros
Bien chers Amis,
« Un saint est mort ! », s’exclament, bouleversés, les habitants de Caracas (Venezuela) à l’annonce du décès accidentel du docteur José Gregorio Hernández Cisneros, le 29 juin 1919. Les funérailles de ce médecin sont un triomphe ; elles font la une des journaux et attirent les autorités civiles, scientifiques, religieuses ainsi que plusieurs milliers de personnes. Devançant le jugement de l’Église, les foules le prient pour obtenir des faveurs ; sa tombe devient un lieu de pèlerinage et, face au témoignage des nombreux miracles, sa réputation de sainteté ne cesse de croître. Un culte populaire s’établit, soit par la vénération de statues à son effigie soit par des neuvaines ; il s’étend même au-delà de l’Église catholique.
 L’ampleur de cette vénération engage les autorités de l’Église catholique à entamer, en 1949, le procès canonique pour une éventuelle béatification. Le 16 janvier 1986, le Pape saint Jean-Paul II déclare vénérable le docteur Hernández Cisneros. À partir de 2018, une enquête canonique est lancée concernant une guérison attribuée au vénérable. Une fillette de dix ans, vénézuélienne, Yaxury Solórzano, a été touchée à la tête par une rafale de fusil à plombs, lors d’un cambriolage de la maison de son père, en mars 2017. Emmenée en urgence à l’hôpital de San Fernando de Apure, avec une blessure au crâne, elle subit une opération en neurochirurgie ; on lui retire une partie de l’os crânien pariétal. Sa vie est sauve, mais, selon les médecins, les conséquences neurologiques seront catastrophiques. Pendant l’intervention, la mère de l’enfant implore avec ferveur l’intercession auprès de Dieu du docteur José Gregorio Hernández ; immédiatement, elle perçoit sa présence, sent une main sur son épaule et entend une voix : « Rassurez-vous, tout ira bien ! » Quelques jours après l’opération, contre toute attente, la fillette récupère de façon étonnante, sans aucune séquelle et avec toutes ses capacités neurologiques. Le 9 janvier 2020, la commission médicale de la Congrégation pour les Causes des Saints a reconnu cette guérison comme inexplicable par la science ; le Pape François a déclaré ce miracle authentique et a signé, le 19 juin 2020, le décret de béatification de José Gregorio Hernández Cisneros.
L’ampleur de cette vénération engage les autorités de l’Église catholique à entamer, en 1949, le procès canonique pour une éventuelle béatification. Le 16 janvier 1986, le Pape saint Jean-Paul II déclare vénérable le docteur Hernández Cisneros. À partir de 2018, une enquête canonique est lancée concernant une guérison attribuée au vénérable. Une fillette de dix ans, vénézuélienne, Yaxury Solórzano, a été touchée à la tête par une rafale de fusil à plombs, lors d’un cambriolage de la maison de son père, en mars 2017. Emmenée en urgence à l’hôpital de San Fernando de Apure, avec une blessure au crâne, elle subit une opération en neurochirurgie ; on lui retire une partie de l’os crânien pariétal. Sa vie est sauve, mais, selon les médecins, les conséquences neurologiques seront catastrophiques. Pendant l’intervention, la mère de l’enfant implore avec ferveur l’intercession auprès de Dieu du docteur José Gregorio Hernández ; immédiatement, elle perçoit sa présence, sent une main sur son épaule et entend une voix : « Rassurez-vous, tout ira bien ! » Quelques jours après l’opération, contre toute attente, la fillette récupère de façon étonnante, sans aucune séquelle et avec toutes ses capacités neurologiques. Le 9 janvier 2020, la commission médicale de la Congrégation pour les Causes des Saints a reconnu cette guérison comme inexplicable par la science ; le Pape François a déclaré ce miracle authentique et a signé, le 19 juin 2020, le décret de béatification de José Gregorio Hernández Cisneros.
José Gregorio Hernández Cisneros est né le 26 octobre 1864 à Isnotú, une localité de l’état de Trujillo au Venezuela. Il est l’aîné de six frères et sœurs. Par sa mère, José Gregorio appartient à la famille du cardinal Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), qui fut le confesseur d’Isabelle la Catholique, reine de Castille et d’Espagne (1451-1504), et le fondateur de l’université d’Alcalá ; et par voie paternelle, il est apparenté au saint Frère Miguel Cordero Muñoz (1854-1910), Frère des Écoles chrétiennes, éducateur et écrivain équatorien. José Gregorio est baptisé trois mois après sa naissance, le 30 janvier 1865.
Le père de famille gère une pharmacie-droguerie. « Ma mère m’a enseigné la vertu dès le berceau, affirmera José Gregorio, elle m’a fait grandir dans la connaissance de Dieu et m’a donné la charité comme guide. » « Soyez attentifs, commente le Pape François : ce sont les mamans qui transmettent la foi ! La foi se transmet en dialecte, c’est-à-dire dans le dialecte que les mères savent parler à leurs enfants. Et vous les mères, soyez attentives à transmettre la foi en ce dialecte maternel » (discours du 13 septembre 2023). Dès l’âge de trois ans, José reçoit le sacrement de Confirmation, comme c’est alors la coutume. Il est âgé de huit ans lorsque sa mère meurt. Après avoir bien avancé dans sa scolarité, il souhaite étudier le droit. Mais son père lui suggère de s’orienter plutôt vers la médecine ; José Gregorio considérera cela comme une vocation. Il lui faut donc se rendre dans la capitale, Caracas. Pour lui qui n’a jamais quitté son village natal, il s’agit d’un long voyage, à dos de mule puis en bateau et en train, dans un pays qui sort d’une période de guerre civile.
Il est scolarisé, de 1878 à 1882, au collège Villegas, dirigé alors par son fondateur, le docteur Guillermo Tell Villegas ; celui-ci et son épouse deviennent bientôt ses amis. L’élève se fait apprécier par ses professeurs et obtient de bons résultats. Il a dix-sept ans lorsqu’il obtient le baccalauréat en philosophie. Il s’inscrit alors à l’Université centrale du Venezuela (UCV) pour commencer des études de médecine. Les appréciations de ses professeurs sont élogieuses : bonne conduite, application, assistance régulière aux cours, succès aux examens. Excellent dans une grande partie des matières, il étudie, de plus, les langues et en vient à parler anglais, allemand, français, italien, portugais ; il a aussi une bonne maîtrise du latin. Il obtient son doctorat en médecine le 29 juin 1888 : il a développé devant le Recteur de l’Université et un jury d’examen des questions liées aux maladies bactériennes, un domaine dans lequel sa profession médicale se concentrera plus tard, car il sera considéré comme le fondateur de la bactériologie au Venezuela.
« Mon poste n’est pas ici »
Le docteur Dominici, recteur de l’Université, propose son aide financière à José Gregorio devenu médecin pour ouvrir un cabinet médical à Caracas. « Cher docteur Dominici, lui répond celui-ci, je vous suis très reconnaissant pour votre proposition, mais j’ai la conviction que mon poste n’est pas ici. Je dois retourner dans mon village. À Isnotú, il n’y a pas de médecin, et c’est là que je dois aller, c’est là que ma propre mère m’a demandé de revenir pour soulager la douleur des pauvres gens de notre terre. Maintenant que je suis médecin, je me rends compte que ma place est parmi les miens. » Il repart donc pour Isnotú en août 1888. Il a vingt-quatre ans. Le 18 septembre, il écrit à son ami : « J’ai reçu un bon accueil de mes patients, mais il est difficile de prendre soin des gens, ici, parce qu’il faut lutter contre bien des préjugés fortement enracinés : ils croient en certains remèdes qui consistent à prononcer quelques paroles. La clinique est très pauvre : tout le monde souffre de dysenterie… Les thérapies sont encore plus déplorables… »
Un an plus tard, il se rend dans les trois États andins du Venezuela (Trujillo, Mérida et Táchira), où il cherche en vain à établir un centre à partir duquel il pourrait rayonner. De retour à Isnotú, il trouve une lettre de l’un de ses anciens professeurs, le docteur Calixto González, l’informant qu’il l’a recommandé au gouvernement pour l’attribution d’une bourse d’études en Europe. En effet, devant la pénurie de médecins dédiés à la recherche expérimentale, le président de la République, Juan Pablo Rojas Paúl (1826-1905, président de 1888 à 1890) a décrété qu’un jeune médecin vénézuélien serait envoyé en France, pour l’année 1889. Il devrait ensuite rentrer à Caracas et faire bénéficier le pays de la science acquise. Avide de connaissances, d’esprit curieux, José Gregorio s’avère être un chercheur par vocation ; il possède toutes les dispositions souhaitables pour tirer profit de ce voyage d’études.
Arrivé à Paris en novembre 1889, José Gregorio s’adonne à la recherche dans le laboratoire de Charles Richet (prix Nobel en 1913), professeur de physiologie expérimentale à l’École de médecine. Il est particulièrement intéressé par les travaux de Mathias Duval, spécialiste d’histologie de bactériologie, et d’embryologie. D’autre part, il entre en contact avec des œuvres chrétiennes sociales comme la Société de Saint-Vincent-de-Paul fondée par le bienheureux Frédéric Ozanam et ses amis. Désireux de connaître les innovations scientifiques allemandes, il se rend à Berlin avant de rentrer au Venezuela. José Gregorio est alors nommé, à vingt-six ans, professeur à l’Université de Caracas ; sur la demande du gouvernement, il fait venir d’Europe plusieurs médecins pour l’hôpital de Vargas. Il participe, en 1890, à l’installation d’une école d’infirmières. L’année suivante, après un nouveau voyage en Europe, il inaugure, comme titulaire, la chaire d’histologie ainsi que de physiologie expérimentale à l’université de Caracas. Il fonde aussi la première chaire de bactériologie d’Amérique. Le gouvernement lui accorde une aide financière importante pour qu’il puisse se procurer le matériel nécessaire et les ouvrages essentiels sur ces nouvelles matières. Mais son pénible travail de pionnier se heurte parfois à des incompréhensions.
Des ouvrages scientifiques
Le jeune professeur introduit au Venezuela l’usage du microscope, instrument indispensable pour la recherche ; il se procure également d’autres appareils scientifiques, en particulier pour l’étude de la microbiologie. En 1893, il écrit plusieurs articles dans la “Gaceta Médica”, et, en 1906, publie “Elementos de Bacteriología”, un ouvrage classé par les experts comme un prodige de concision et de clarté. Il publiera encore onze ouvrages scientifiques (deux autres resteront inédits), et, entre 1907 et 1912, cinq œuvres littéraires. Par tempérament et par inclination, José Gregorio est un philosophe profond mais aussi un artiste à la sensibilité raffinée. De caractère réfléchi, doté d’un délicat sens critique, il est préoccupé par les grands problèmes de l’homme. Dans ses “Elementos de Filosofía” (1912), il expose sa vision du monde et des relations des hommes entre eux et avec Dieu.
Catholique actif au niveau local et national, José Gregorio entre dans le Tiers-Ordre franciscain, le 7 décembre 1899, au sein de la paroisse de Notre-Dame de la Merci à Caracas. Sa vie privée et professionnelle est tout imprégnée de l’esprit de saint François. Patient et pauvre en tout, il s’applique à voir et servir Jésus en chaque personne. Le “Tiers-Ordre” a été fondé par saint François d’Assise en 1221 pour les laïcs des deux sexes voulant vivre, autant que possible, de sa spiritualité tout en restant dans le monde ; les prêtres diocésains peuvent aussi en faire partie. Parmi les membres illustres de ce tiers ordre, on trouve le roi saint Louis et plusieurs Papes, dont Léon XIII. Ces “tertiaires” s’appliquent à nourrir leur vie de prière par l’étude des vérités de la foi, et à puiser dans une grande dévotion à la Passion du Christ, un amour concret du prochain. Cette institution a servi de modèle pour d’autres associations de laïcs dépendant d’Ordres religieux.
L’intimité avec Dieu
« D’où José Gregorio tenait-il tout son enthousiasme, tout son zèle ? demande le Pape François. Cela venait d’une certitude et d’une force. La certitude était dans la grâce de Dieu. Il écrivait que “s’il y a des bons et des mauvais dans le monde, les mauvais y sont parce qu’ils sont devenus mauvais eux-mêmes, mais les bons ne le sont qu’avec l’aide de Dieu” (27 mai 1914). Et lui, en premier, se sentait indigent de la grâce qu’il mendiait, et il avait grand besoin de l’amour. Et voici la force dont il s’inspirait : l’intimité avec Dieu. C’était un homme de prière – il y a la grâce de Dieu et l’intimité avec le Seigneur – c’était un homme de prière qui participait à la Messe » (13 septembre 2023).
José Gregorio répondait à l’amour gratuit de Dieu qui nous a créés et nous appelle à exercer la vertu de foi. « Le Concile Vatican II, écrivait saint Jean-Paul II, déclare qu’“à Dieu qui révèle il faut apporter l’obéissance de la foi” (Constitution Dei Verbum, n°5). Par cette affirmation brève mais dense, est exprimée une vérité fondamentale du christianisme. On dit tout d’abord que la foi est une réponse d’obéissance à Dieu. Cela implique qu’Il soit reconnu dans sa divinité, dans sa transcendance et dans sa liberté suprême. Le Dieu qui se fait connaître dans l’autorité de sa transcendance absolue apporte aussi des motifs pour la crédibilité de ce qu’il révèle. Par la foi, l’homme donne son assentiment à ce témoignage divin. Cela signifie qu’il reconnaît pleinement et intégralement la vérité de ce qui est révélé parce que c’est Dieu lui-même qui s’en porte garant… C’est pour cela que l’acte par lequel l’homme s’offre à Dieu a toujours été considéré par l’Église comme un moment de choix fondamental où toute la personne est impliquée… Dans la foi, la liberté n’est pas seulement présente, elle est exigée. Et c’est même la foi qui permet à chacun d’exprimer au mieux sa liberté. Autrement dit, la liberté ne se réalise pas dans les choix qui sont contre Dieu… C’est lorsqu’elle croit que la personne pose l’acte le plus significatif de son existence ; car ici la liberté rejoint la certitude de la vérité et décide de vivre en elle » (Jean-Paul II, encyclique Fides et ratio, 14 septembre 1998, n°13).
En 1907, José Gregorio décide de s’orienter vers la vie religieuse. Après avoir consulté l’archevêque de Caracas, Mgr Juan Bautista Castro, il écrit au Prieur de la Chartreuse de Farmeta, près de Lucques en Italie (les Chartreux, moines purement contemplatifs, ont été fondés au xie siècle par saint Bruno). Reçu au noviciat, José Gregorio prend le nom de Frère Marcel. Mais après quelques mois, il est atteint d’une maladie si grave que le Prieur juge préférable de le renvoyer se rétablir au Venezuela. De retour à Caracas en avril 1909, il est admis au séminaire Sainte-Rose de Lima ; toutefois, le désir de la vie monastique demeure ancré dans son âme. Trois ans plus tard, il se rend au “Collegio Pío-Latino-Americano” de Rome, pour y suivre les cours de théologie. Il estime que la prêtrise est « la plus grande chose qui existe sur terre ». Mais, à nouveau, une affection pulmonaire le contraint à retourner dans son pays natal.
Guérir et protéger
Le 14 septembre 1909, José Gregorio est nommé professeur titulaire de la chaire d’anatomie-pathologique, science qui consiste à identifier diverses maladies, en examinant des petits prélèvements à l’œil nu ou au microscope, permettant des diagnostics de grande précision. Il lui faut coopérer à la fondation d’un laboratoire d’analyses lié aux services de l’hôpital Vargas ; il en sera chargé jusqu’en 1911. Il donne une impulsion pour la recherche et l’enseignement dans des matières médicales importantes, dont il est alors le seul spécialiste. Il est aussi considéré comme l’introducteur dans le pays de l’application de la chimie et des mathématiques dans les disciplines biologiques et physiologiques. Parmi les grands professeurs de médecine, il excelle comme un enseignant hors pair : il inaugure un enseignement véritablement scientifique et pédagogique, basé sur l’observation des phénomènes vitaux et des tests de laboratoire. Il forme une école de chercheurs qui auront un très grand rôle dans la médecine du pays ; on compte parmi eux Rafael Ragel, le fondateur de la parasitologie. Les applications des expériences de José Gregorio sont orientées vers la finalité suprême de la médecine, qui n’est autre que guérir les malades et protéger la vie qu’ils tiennent de Dieu.
De nos jours, comme l’affirmait le Pape saint Jean-Paul II, « dans le cadre de la recherche scientifique, on en est venu à imposer une mentalité positiviste qui s’est non seulement éloignée de toute référence à la vision chrétienne du monde, mais qui a aussi et surtout laissé de côté toute référence à une conception métaphysique et morale. En conséquence, certains hommes de science, privés de tout repère éthique, risquent de ne plus avoir comme centres d’intérêt la personne et l’ensemble de sa vie » (ibid., n°46).
À la fin de 1912, le gouvernement dictatorial du général Juan Vicente Gómez décrète la fermeture de l’Université, qui s’est montrée hostile à son régime. En 1914 et 1915, avec Inocente Carvallo, le docteur Hernández donne des cours de médecine en privé et sans rémunération au Colegio Villavicencio. Pendant ses temps libres, il exerce dans un cabinet médical privé, et dispose d’une salle de consultation à son domicile. Entre 1915 et 1917, lorsque l’Université rouvre ses portes, il prend part à la restauration de l’enseignement médical. En 1917, il fait un nouveau voyage scientifique aux États-Unis, puis à Madrid. De retour l’année suivante, il est le premier à montrer à ses étudiants la manière de mesurer la pression artérielle. Il met fin à son enseignement universitaire en janvier 1918, mais reprend du service, comme simple médecin, lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918-1919. Il continue aussi à soigner gratuitement les pauvres, leur achetant personnellement, s’il le faut, les médicaments dont ils ont besoin.
Au cours de l’audience générale du 13 septembre 2023, le Pape François affirmera : « José Gregorio était un homme humble, un homme aimable et serviable. En même temps il était animé d’un feu intérieur, d’un désir de vivre au service de Dieu et du prochain. Poussé par cette ardeur, il essaya à plusieurs reprises de devenir religieux et prêtre, mais divers problèmes de santé l’en empêchèrent. Sa fragilité physique ne l’a pas conduit à se renfermer sur lui-même, mais à devenir un médecin encore plus sensible aux besoins des autres… Voilà le véritable zèle apostolique : il ne suit pas ses propres aspirations, mais la disponibilité aux desseins de Dieu. C’est ainsi que le bienheureux comprit qu’en soignant les malades, il mettait en pratique la volonté de Dieu, en aidant les souffrants, en donnant de l’espérance aux pauvres, en témoignant la foi non pas avec des paroles mais avec des actes. C’est ainsi qu’il pratiqua la médecine comme un sacerdoce. »
Au contact de Jésus, qui s’offre pour tous sur l’autel, à la Messe, José Gregorio se sent appelé à offrir sa vie pour la paix, alors que le premier conflit mondial est en cours. Le 29 juin 1919, un ami lui rend visite et le trouve très heureux. José Gregorio a en effet appris la signature du traité mettant fin à la guerre. Son offrande, pense-t-il, a été accueillie, et il pressent que sa tâche sur terre est terminée. Ce matin-là, comme d’habitude, il va à la Messe après laquelle il entre dans une pharmacie pour acheter des médicaments à l’intention d’un malade. En traversant la rue, à la sortie de l’officine, il est percuté par un véhicule ; transporté à l’hôpital, il reçoit l’Extrême-Onction, et meurt après avoir murmuré : « Ô Sainte Vierge ! » Il est âgé de cinquante-quatre ans. Pendant qu’il recevait les derniers sacrements, Mère Candelaria de Saint-Joseph, religieuse fondatrice d’Ordre, qui sera déclarée bienheureuse en 2008 par saint Jean-Paul II, hospitalisée dans le même établissement et mise au courant de l’accident, priait pour lui. Son voyage terrestre se termine ainsi, en accomplissant une œuvre de miséricorde, et dans un hôpital où il avait fait de son travail de médecin un chef-d’œuvre de compétence et de charité.
Étoile polaire
« La charité fut l’étoile polaire qui orienta l’existence du bienheureux José Gregorio, disait le Pape François : bon et d’humeur joyeuse, il était doué d’une grande intelligence et devint médecin, professeur d’université et scientifique. Mais il fut surtout un médecin proche des plus faibles, au point d’être connu dans sa patrie comme “le médecin des pauvres”. Il s’occupait des pauvres, toujours. À la richesse de l’argent, il préféra celle de l’Évangile, dépensant sa vie pour aider les nécessiteux. Dans les pauvres, les malades, les émigrés, les souffrants, José Gregorio voyait Jésus. Et le succès qu’il ne chercha jamais dans le monde, il le reçut, et continue de le recevoir, des gens qui l’appellent “saint du peuple”, “apôtre de la charité”, “missionnaire de l’espérance” » (13 septembre 2023).
Que le bienheureux nous apprenne à exercer toutes les actions de nos journées à la lumière de l’Évangile ! Alors, notre prochain pourra percevoir l’action de Dieu dans les événements, et parvenir à la connaissance du Christ, seul Sauveur. « Puisse Marie, le Trône de la Sagesse, être le refuge sûr de ceux qui font de leur vie une recherche de la sagesse ! » (saint Jean-Paul II, Fides et ratio, n°108).